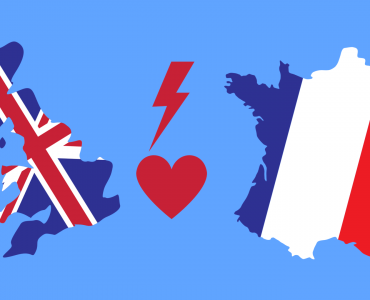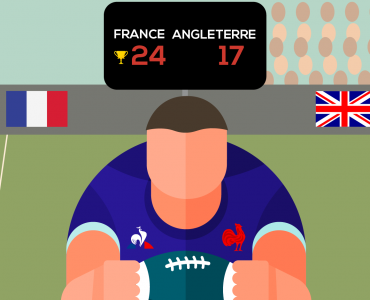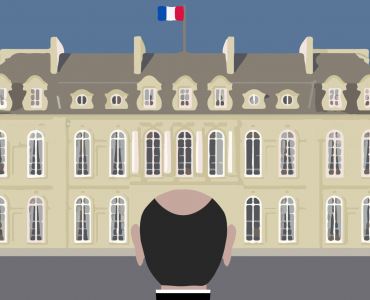Aux nouveaux maux, les mêmes remèdes. Le “quoi-qu’il-en-coûte”, topos usé jusqu’à la corde par les décideurs économiques, a connu son heure de gloire lors du règlement de la crise de 2008 en Europe. En promettant de racheter les actifs viciés détenus par les pays européens, le séducteur Draghi, président de la BCE de l’époque, fixait les anticipations des agents en même temps qu’une nouvelle pratique de fonctionnement de la politique monétaire et maintenait à flots le système bancaire européen. Un credo repris en chœur dix ans plus tard par le Premier ministre français dans le cadre de la gestion économique de l’épidémie : « Nous devons assumer ces dépenses, car ne rien faire aurait un coût économique, financier, et surtout humain, encore plus considérable » (Evangile selon Jean.C, 12-20). En promettant de faire le nécessaire pour sauver des eaux les entreprises et les employés en difficulté, il allie une relance keynésienne consensuelle et une transparence nécessaire vis-à-vis de la population. Une politique qui devrait vite faire grimper la dette au-delà de 120% du PIB en 2021 et qui acte le fait que désormais la République se vit à découvert bancaire.
Nous autres, États, nous savons maintenant que nous sommes immortels
Emmanuel Macron, en déclarant qu’il entend aider coûte-que-coûte les entreprises, oublie de préciser le fait qu’il ne débourse rien pour couvrir les subventions qu’il distribue. En effet, l’Agence France Trésor a autant de facilité à lever sa dette que Booba son troisième doigt. Lors de l’ouverture du livre d’ordres le 19 janvier dernier, 75 milliards ont été réclamés par des investisseurs chaque fois plus nombreux et assoiffés d’engloutir un morceau de nos déboires. Le gouvernement ne cherchait que 7 milliards et les a obtenus à des taux défiants toute concurrence (0.59% à 50 ans et négatifs à 10 ans). La conséquence de ces taux bas est que si la dette a été multipliée par deux en 20 ans, sa charge en pourcentage du PIB a été, elle, divisée de moitié. Par ailleurs, le spread entre les emprunts allemands et français se maintient à 22 points de base, un des écarts les plus faibles enregistrés depuis des années.
Les agents économiques ne semblent pas se détourner d’une dette publique française qui ne cesse d’avoir la cote. Ceci notamment parce que les investisseurs considèrent la mort des Etats comme suffisamment invraisemblable pour que les titres qu’ils possèdent soient sécurisés. Si on ajoute à cela une frilosité des marchés qui refusent tout excès de prise de risque et la mauvaise santé des entreprises grippées par l’épidémie, on comprend facilement cette ruée vers l’or souverain.
Défense de la dépense
La dette a toujours eu mauvaise presse dans les journaux et dans l’opinion publique. En France, où la gestion budgétaire quasi monacale a la préférence de tous depuis des décennies, on est particulièrement réticent à dépenser ce que l’on ne possède pas. Une croyance quelque peu faussée si l’on admet que l’endettement n’est qu’un moyen ingénieux de répartir optimalement la consommation de ses ressources sur l’ensemble de son existence. La naissance du système bancaire, n’en déplaise aux tenants de l’anticapitalisme, a ainsi permis un lissage de la consommation au bénéfice de tous. Il autorise celui qui gagnera plus tard à ne pas mourir de faim aujourd’hui. Il en va de même pour les Etats, avec l’avantage supplémentaire que leur durée de vie est supposée infinie. Ils ont ainsi la possibilité de « rouler » sur leur dette, c’est-à-dire de rembourser et de réemprunter perpétuellement, et ce jusqu’à la fin des temps. L’Etat n’a donc à se préoccuper que de la charge de la dette (les intérêts qu’il doit payer), et non du principal, qu’il ne remboursera en réalité jamais.
Si la dette peut effectivement être critiquée, c’est plutôt en raison de ses caractéristiques. Les économistes aiment distinguer dette de fonctionnement et dette d’investissement. Lorsqu’une institution doit emprunter pour couvrir ses dépenses courantes et payer ses employés, les experts y voient à raison une mauvaise gestion, mère d’une dette peu souhaitable. En revanche, lorsqu’il s’agit de couvrir des dépenses d’investissements coûteuses, l’Etat fait simplement le pari de ressources futures. D’où une remise en cause permanente de la règle européenne de limitation du déficit à 3% (âprement débattue comme le montre cet article) qui ne prend pas en compte l’éventualité d’investissements lourds qu’un gouvernement peut être amené à déployer. Notons également que le risque de surendettement est bien plus médiatisé que celui de sous-investissement. Les marchés et les médias s’affolent suffisamment sur la question de l’augmentation de la dette pour assurer sa visibilité. Le manque d’investissement, en revanche, est un mal caché, accéléré par le manque de confiance des agents économiques et que l’Etat tente de pallier au prix d’un creusement de son déficit et de sa dette.
Pour beaucoup, si la dette n’est pas forcément néfaste, elle est en revanche largement inefficace en raison de l’effet d’éviction qu’elle engendre. Les individus, anticipant une hausse future des impôts, choisiraient d’épargner cet argent plutôt que de le dépenser. Un scénario qui paraît improbable dans le cadre du fonds de solidarité et des allocations de chômage partiel. En effet, l’argent distribué est souvent de première nécessité pour les individus et entreprises qui le perçoivent. Il y a donc peu de risques de report complet de ces dépenses publiques en épargne de précaution. La dette compense ici d’une part la mise de côté forcée due aux différents confinements et d’autre part la consommation de ceux qui ont vu leurs revenus diminuer.
Lire aussi : Et la sentence tomba sur Karlsruhe…
Qui va payer des millions ?
La France s’engage donc dans un coûtera-que-coûte, le poids financier des mesures actuelles est laissé à des temps futurs et qu’on espère lointains. Qui dit procrastination et augmentation de la dette dit besoin pour l’Etat que cette dette soit soutenable. A propos du volume optimal de dette, les rapports d’experts prédisaient déjà une dette non soutenable à 60% du PIB en 2005. Même s’il est évident que plus la dette augmente et plus le risque de défaut s’accroît, il est difficile de déterminer un volume seuil au-delà duquel on clamerait solennellement la banqueroute de l’Etat. Reste la possibilité de se voir confrontés à un retournement des taux d’intérêts. Cette hypothèse est-elle envisageable ?
Pour le moment ce n’est pas le cas et la dette liée au coronavirus ne changera probablement pas cet état de fait si les investisseurs la regardent pour ce qu’elle est vraiment à savoir une mesure d’urgence et que l’on espère conjoncturelle. En effet, pour voir les taux remonter, il faudrait que les détenteurs d’OAT aient un doute sur la capacité du pays à s’acquitter de ses paiements. Or la dette Covid peut être vue comme temporaire et exceptionnelle car elle ne provient pas d’un déficit structurel de l’économie française. A ce titre, on peut imaginer que le rebond économique qui devrait logiquement succéder à la reprise de l’activité s’accompagnera d’un taux de croissance largement supérieur aux intérêts sur la dette. De quoi rassurer les investisseurs.
Il est toutefois nécessaire de se montrer soucieux de limiter la dette voire de la réduire, ce qu’a assuré Bruno Le Maire lors de sa dernière audition à la Commission des Finances de l’Assemblée nationale. Contrairement à l’amour, en matière de dette publique, des promesses peuvent suffire… à condition que les investisseurs y croient suffisamment. Après avoir promis coûte-que-coûte de s’endetter, le gouvernement assure qu’il contiendra coûte-que-coûte cette dette. Une politique apparemment volontariste qui peut interroger sur l’origine des fonds employés pour la mettre en œuvre. Habituellement, on considère la dette comme contrôlable car le gouvernement dispose de deux leviers pour s’en assurer. D’une part, il a la capacité de lever de nouveaux impôts et d’autre part, il peut choisir de monétiser sa dette. La première solution est de moins en moins évidente à imposer dans la mesure où les taux de prélèvements obligatoires sont déjà élevés. Quant à la deuxième, elle n’est tout simplement plus possible, le contrôle de la masse monétaire restant sous la garde de la présidente de la BCE.
Une addition salée, en définitive, que l’Etat entendra sûrement partager avec ses contribuables. Un manque de délicatesse qui ne devrait pas être du goût de tous mais qui n’a pas d’autre alternative viable pour nourrir toutes les bouches de la République d’ici à la sortie de crise.
Du même auteur :
PC : Larmes à gauche