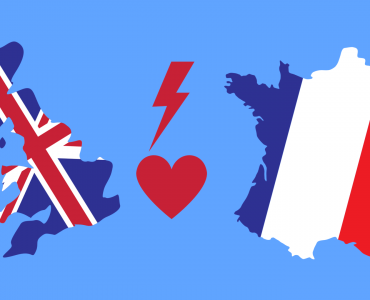Rares sont les décisions qui sortent du monde très fermé des juristes pour entrer dans celui du débat public. La décision OMT-Program de la Cour constitutionnelle allemande, en date du 5 mai 2020 est de celles-ci. Il faut dire que l’affaire, née d’un sulfureux ménage à trois entre Luxembourg, Karlsruhe et Francfort, est complexe, tant elle mêle des considérations juridiques, politiques, économiques. En France, l’arrêt de la Cour de Karlsruhe a suscité une levée de boucliers quasi-unanime. Les auteurs de ces lignes estiment quant à eux qu’il faut raison garder.
Questionner le principe de primauté
La décision du juge constitutionnel allemand a été vivement critiquée en ce qu’elle remettait en question le principe de primauté, selon lequel des États membres de l’Union européenne 1Ce par quoi il faut entendre les institutions des États membres, dont leur gouvernement, leurs juges, leur parlement. ne peuvent pas prendre de mesure unilatérale contrevenant au droit communautaire. Or, il serait ici bon de rappeler que le principe de primauté, brandi aujourd’hui de tous bords, n’apparaît nulle part dans le droit positif européen, qu’il soit primaire (traités) ou dérivé (directives, règlements). Son unique fondement, si tant est qu’il puisse être qualifié ainsi, est un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 15 juillet 1964, passé à la postérité sous le nom de Costa c. ENEL ; une jurisprudence qui n’a pas de force contraignante 2Le principe du case law, dans lequel les cours inférieures sont tenues aux décisions des supérieures, et dans lequel toute cour doit respecter ses décisions passées, ne s’applique pas ici.. Si le principe de primauté est si capital pour la construction européenne, pourquoi les États membres n’ont-ils pas, durant les cinquante années qui nous séparent de Costa c. ENEL, pris l’initiative de le graver dans le marbre des traités ?
C’est qu’il est très délicat de circonscrire le domaine du principe de primauté. Dans son acception la plus large, le principe de primauté implique que toute norme de droit interne, y compris les constitutions des Etats membres, doit se conformer au droit européen, ce que les juges nationaux n’ont jamais accepté explicitement 3Ainsi, en France, le Conseil d’État, juge suprême de l’ordre administratif, considère depuis longtemps que le droit européen ne peut primer sur le droit national que dans la mesure où la Constitution de 1958 le lui permettait. Une sorte de pacte de non-agression s’est constitué entre la Cour de Luxembourg et les juges nationaux pour que la question n’ait jamais à être tranchée.. Cette approche est légitimée par l’article 4 du Traité sur l’Union européenne, qui reconnaît l’identité nationale (comprise comme identité constitutionnelle) des États membres. L’enjeu de ce débat, bien sûr, est éminemment politique. Affirmer que le droit européen prévaut sur les constitutions nationales, c’est affirmer a fortiori que le principe même de la souveraineté – comprise comme faculté, pour un peuple, à se donner ses propres normes – réside dans l’Union. Une thèse qui ne suscite pas l’unanimité. Présenter le droit européen comme une unique et monolithique pyramide de normes avec le droit communautaire à son sommet et les droits nationaux à la base, comme cela a pu être fait dans la presse française ces derniers jours, est donc abusif, voire trompeur. La procédure du renvoi préjudiciel 4Supposons qu’un juge national ait à trancher un litige en faisant application du droit européen, mais qu’il doute de la manière dont ce droit doit être appliqué. Il adresse alors un renvoi préjudiciel à la CJUE, qui répond en donnant son interprétation du droit européen. Le juge national peut ensuite trancher le litige. met en lumière ces mêmes contradictions. A l’occasion d’un tel renvoi, la CJUE se prononce sur le fond (l’interprétation du droit) et non sur les faits (la solution concrète au problème soulevé) 5En cela, la procédure européenne se distingue radicalement de celle qui prévaut aux Etats-Unis, système authentiquement fédéral où la Cour Suprême peut statuer sur les faits.. Elle ne prend pas de décision juridiquement contraignante, dans le sens où ses arrêts ne jouissent pas de l’autorité de la chose jugée. L’usage veut que le juge national s’efforce d’appliquer aux faits présentés la solution qui se déduirait de l’arrêt de la CJUE. Mais le processus n’a rien d’automatique 6Voir pour un exemple de résistance du juge national la décision CJUE du 4 octobre 2018 condamnant le Conseil d’État du fait de sa jurisprudence., et les juges de Luxembourg peuvent aussi répondre à côté du problème de droit qui leur est posé par le juge national.
La complexité de l’affaire tient également à la manière dont sont réparties les compétences au sein de l’Union européenne. Si la politique monétaire est une compétence exclusive de l’Union (corollaire de l’union monétaire) 7Article 3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne., la politique budgétaire demeure de la compétence des États. Or, si la BCE utilise la politique monétaire pour réduire les taux, elle influence également la politique budgétaire des États membres puisqu’elle les incite à emprunter. Nombreux sont ceux qui diront que cet argument des juges allemands est fallacieux, dans la mesure où la politique monétaire influence toujours la politique budgétaire ; mais tel n’est pas le postulat du traité. Celui-ci considère en effet que la principale mission de la BCE est de maintenir la stabilité des prix. En clair, il condamne la BCE à l’inaction, ou du moins à une posture passive face aux événements. La BCE ne pouvant agir, ne peut mal agir. Dans le cas contraire, si celle-ci ne respecte pas les traités, il y a lieu de remettre en question son indépendance.
A cela s’ajoute un problème d’adéquation entre l’action de la BCE dans la décennie 2010 et les objectifs qui lui sont fixés par les traités. Les traités européens prohibent explicitement la monétisation des déficits publics. L’article 127 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose : « l’objectif principal du Système européen de banques centrales, ci-après dénommé SEBC, est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l’objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l’Union, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union ». Au sens du traité, le maintien de la stabilité des prix est pour la BCE l’ un objectif principal. La réduction des disparités macroéconomiques, régionales et sociales, n’est qu’un objectif secondaire. Bien sûr, il y a lieu de contester la pertinence de cette hiérarchie, cela va sans dire. Il n’empêche que cette hiérarchie est ce qu’elle est, et que la fonction d’un juge – constitutionnel qui plus est – n’est pas d’inventer des règles ou de modifier les normes qui se présentent à lui, mais d’en assurer la bonne exécution.
Éviter une convergence au rabais
Revenons sur la répartition des compétences entre la politique monétaire et la politique budgétaire. La politique monétaire a effectivement été transférée à la BCE, qui détermine seule les grandes orientations monétaires qui s’appliqueront uniformément à l’ensemble des pays de la zone euro. Dans le même temps, la politique budgétaire reste l’apanage exclusif des Etats 8Cette répartition entre les États et la zone euro est cohérente vis- à- vis du modèle IS LM BP. Le modèle IS LM BP, développé à l’origine par l’économiste américain Alvin Hansen et enrichi par le canadien Robert Mundell, cherche à représenter l’impact macroéconomique de différentes politiques économiques, selon que l’on fasse varier les dépenses publiques et les taux d’intérêts directeurs, en prenant également en compte la situation du taux de change et donc l’impact de la contrainte extérieure sur les politiques économiques nationales.. Pour résumer, la politique monétaire de Francfort répond aux chocs symétriques affectant la zone (c’est à dire les chocs qui touchent tous les pays uniformément), et les politiques budgétaires permettent à chaque État de lutter contre les chocs asymétriques, qui les concernent spécifiquement.
Il est devenu classique d’attribuer les performances en demi-teinte des Etats de la zone euro aux règles budgétaires jugées trop contraignantes qui pèsent sur leurs dépenses publiques. Rappelons tout de même que dans les faits, le non-respect de ces règles est très fréquent. Les États sont devenus experts pour justifier des écarts, et la Commission elle-même rechigne souvent à infliger les (petites) amendes aux pays ne respectant pas le pacte. C’est d’ailleurs bien là le problème… Mais tâchons d’expliquer l’intérêt de ces règles (les fameux 3% de déficit et les 0,5% de déficit structurel) et de montrer pourquoi ces règles sont saines et nécessaires compte tenu du policy mix européen.
Privés de l’outil monétaire, les pays de la zone peuvent être tentés d’utiliser l’arme budgétaire et de pratiquer des déficits en cas de choc. Cette crainte, déjà exprimée par le Comité Delors en 1989, a justifié l’encadrement de la dépense publique des Etats membres. Avant la mise en place de l’euro (et donc du temps où chaque Etat disposait de sa monnaie propre), lorsqu’un pays était confronté à de fortes difficultés économiques, celui-ci pouvait relancer l’activité par la dépense publique en faisant jouer les vertus, supposées ou réelles, de l’effet multiplicateur keynésien 9L’augmentation globale de la demande entraînant une augmentation proportionnelle du revenu.. La possibilité d’une dépense publique sans limite, mêlée à la mise en commun d’une monnaie unique, peut alors pousser certains États à se comporter comme des passagers clandestins. Un pays très endetté, avec de forts déficits budgétaires pourrait anticiper une monétisation de sa dette par la BCE au travers des multiples politiques non conventionnelles qu’elle mène actuellement. Les mauvais élèves font donc supporter le coût en termes d’inflation et de crédibilité de la politique monétaire de la zone euro à leurs autres camarades, ce qui, on peut le comprendre, ne fait pas plaisir aux premiers de la classe.
Dans cette perspective, la BCE est condamnée à réparer les pots cassés, et à les faire payer à ceux qui gèrent correctement leur dépense publique. En volant au secours des Italiens, des Grecs et des Espagnols, la BCE joue au pompier pyromane et rend ces pays (et les marchés financiers) addicts à l’argent facile. Cela alors même que dès les années 2000-2007, les pays du Sud ont engagé un régime de croissance fondé sur l’endettement, où des bulles se sont formées 10Comme dans le secteur immobilier espagnol par exemple. Depuis le début du siècle, le dérapage des dépenses publiques a déjà causé bien du tort à l’euro ; à croire que les leçons de la crise précédente n’ont pas été tirées.. Cette forme de capitalisme patrimonial est artificiellement soutenue par la baisse des taux d’intérêts réels bas grâce à une inflation supérieure à la moyenne de l’UE. Participent également à cette croissance soutenue la progression des dépenses publiques notamment sociales ainsi qu’une augmentation significative des rémunérations, au-delà des gains de productivité, ce qui engendre une perte de compétitivité par rapport aux autres pays membres qui eux, ont entrepris des réformes et comprimé leur demande interne. Tout ce qu’a fait Mario Draghi, en somme, c’est tenter de se substituer aux profondes défaillances des États membres du Sud via le prolongement des politiques de Quantitative Easing. Ces mêmes politiques ne sont, au fond, qu’un palliatif qui ne pourra jamais se substituer à des politiques structurelles plus ambitieuses, aux abonnées absentes dans les pays qui en auraient le plus besoin.
L’Allemagne, elle, a compris la philosophie du pacte de stabilité : la gestion rigoureuse de ses dépenses publiques pendant les années de croissance conjuguée à la mise en place de réforme structurelles ambitieuses lui ont permis de dégager d’importantes marges de manœuvres budgétaires et donc d’amortir sereinement la crise du « grand confinement ». La France, l’Italie, l’Espagne… déjà en difficulté structurelle, se retrouvent penauds face aux conséquences économiques du coronavirus. Bien mal préparés, dérogeant sans cesse aux règles européennes, ces pays ne sont plus capables de les respecter. Au lieu d’agir pour se hisser au niveau des impératifs qu’ils ont eux-mêmes instauré, ceux-ci souhaitent abaisser leurs niveaux d’exigence, faisant donc planer le risque d’une convergence au rabais…
La sentence est cruelle
In fine, juridiquement et économiquement parlant, c’est donc peu dire que d’affirmer que la décision de la Cour constitutionnelle allemande tient la route. Plutôt que de s’acharner sur ces juges en robe rouge, comme il l’a été fait en France ces derniers jours, et non sans un semblant de cette germanophobie bien gauloise, il faudrait plutôt constater à quel point, d’une part, les hommes politiques français, jamais passionnés par l’économie, se sont désintéressés de ces enjeux au moment de la signature des traités européens, et d’autre part, à quel point une révision de ces mêmes traités devient urgente pour la cohérence de l’ordre juridique européen.