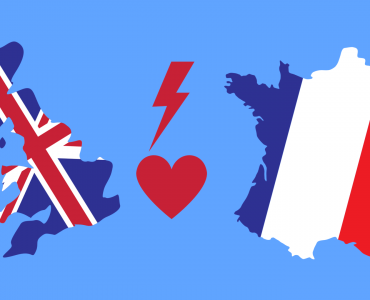Les fusions et acquisitions des grands groupes français et européens défraient souvent la chronique, attisant ressentiment politique et dissensions internes. Dans cette nouvelle série, Victor Pauvert revient pour KIP sur quelques échecs de fusions et d’alliances qui ont marqué l’histoire économique contemporaine. Retour sur des guerres d’égos, de visions stratégiques voire de véritables conflits judiciaires et géopolitiques
Épisode 3 : Daimler-Chrysler, je t’aime, moi non-plus
Dans l’industrie automobile, les fusions manquées sont fréquentes et revêtent une saveur toute particulière, aussi bien par leur médiatisation que par les guerres d’égos engendrées entre des groupes qui considèrent détenir chacun l’équation de succès la plus résiliente. Présentée en 1998 comme la fusion du siècle, tant en termes de montants injectés que de perspectives de réussite, cet accord tourne au fiasco par l’absence totale de synergie et de coopération entre les états-majors respectifs des deux marques. Et ce, au risque de miner, voire de détruire l’avantage concurrentiel forgé par Daimler.
Alliance de titans
Daimler et Chrysler, ce sont deux enfants bénis de l’industrie automobile : une alliance les liant est censée accoucher d’un leader mondial misant sur l’acquisition d’une taille critique comme sur la complémentarité entre les deux marques.
Troisième producteur automobile américain, Chrysler est le plus rentable de ce podium en proposant des véhicules parfaitement adaptés à la classe moyenne américaine. Les marques contrôlées par le groupe sont nombreuses et typiquement américaines : Chrysler, bien sûr, mais aussi Dodge, Jeep et Plymouth. Malgré un positionnement marketing plus que pertinent, Chrysler et ses marques sœurs sont marquées par une image de plus en plus désuète, du fait d’un sous-investissement en recherche et développement. En fait, la rentabilité satisfaisante du groupe est plus liée à ce défaut d’investissement qu’à une vraie performance financière. Par ailleurs, Chrysler pèche par sa focalisation sur le marché américain, et son internationalisation est aussi fragile que peu rentable.
De l’autre côté de la table, Daimler est un géant incontesté de l’automobile allemande, dont le succès est incarné par la marque premium Mercedes-Benz. Le groupe allemand pallie un certain nombre des faiblesses de Chrysler. Vendeur de véhicules de luxe, Daimler est présent internationalement et dégage une marge confortable sur la vente de ses véhicules, tout en maintenant un fort niveau d’investissement en recherche et développement. Pourquoi Daimler veut-il alors s’associer à Chrysler ? Pour atteindre une taille critique face à ses concurrents allemands, qui entament, à l’instar du Volkswagen de Ferdinand Piëch, un processus de concentration par le rachat à tout-va de marques allemandes et étrangères.
Au vu de la surface commerciale et financière des deux groupes, les montants de cette fusion sont vertigineux. Si les chiffres d’affaires de Daimler (68,9 milliards de dollars en 1997) et de Chrysler (59,4 la même année) sont proches, les valorisations des deux groupes varient du simple au double : 52 milliards pour l’allemand pour seulement 27 milliards pour l’américain la même année. Malgré tout, Daimler débourse la folle somme de 36 milliards d’euros, soit les deux tiers de sa propre capitalisation, pour s’offrir Chrysler, dans ce qui apparaît plus comme un rachat que comme une véritable fusion à parts égales. Et cette inégalité à la naissance de la fusion va se traduire par une fatale mésentente.
Guéguerre
Il faut dire que les mésententes se font sentir rapidement. En 1999, soit seulement un an après la fusion, Daimler prend conscience que la situation de Chrysler n’est pas aussi bonne qu’elle le paraissait. Attaquée dans le cœur de sa gamme, le monospace et les véhicules généralistes, la marque américaine peine à survivre face à des concurrents japonais et coréens de plus en plus offensifs. Plus efficaces dans leur gestion des coûts, ils inondent le marché américain avec des véhicules mieux équipés, plus fiables et moins onéreux. Conscient que l’origine américaine des véhicules Chrysler ne suffit plus pour conférer à la marque un avantage concurrentiel durable, l’état-major issu de la fusion décide d’une stratégie « discount » pour aligner les tarifs de Chrysler sur la concurrence, et ce avant même de s’attaquer à une structure de coûts à l’efficacité douteuse. Résultat : des marges en baisse, malgré la stagnation des parts de marché du groupe. À cette situation, s’ajoutent des problématiques inhérentes au fonctionnement et à la gamme de la marque : la dépendance aux 4×4 produits par Jeep fragilise le groupe du fait d’une demande désormais axée sur des véhicules plus compacts et moins consommateurs de carburant. Par ailleurs, champion du leasing, Chrysler peine à revendre son immense stock de véhicules d’occasion. Le groupe américain apparaît donc vite comme le canard boiteux de la fusion.
Face à ce constat, les dirigeants de Daimler recherchent en urgence les synergies possibles entre les deux groupes. Il faut développer rapidement et à moindre coût des véhicules en commun, adaptables à tous les marchés. Ainsi, deux modèles Chrysler sont développés et, pour la première fois, commercialisés en Europe. Il s’agit d’une imposante berline, la 300c, qui est en fait une Mercedes classe E recarrossée, et d’un coupé, la Crossfire, adaptée du cabriolet Mercedes SLK. Présentés en 2004, ces modèles, par leur conception allemande et leur taille compacte, ne conquièrent pas la clientèle traditionnelle de Chrysler, sans non plus satisfaire la clientèle européenne du fait d’un déficit d’image de la marque américaine en Europe. La production de la Crossfire, l’échec le plus retentissant de ce couple maudit, est arrêtée en 2007, moins de trois ans après son lancement. Au total, 76 014 exemplaires du coupé mal né trouvent preneur.
Les raisons de l’échec de ces modèles, et, plus généralement, du groupe formé de la fusion, sont plus structurelles. Un conflit culturel mine la bonne entente entre les états-majors des deux groupes ayant gardé une autonomie relative. Pour reprendre un résumé de Frédéric Lejoint dans l’Écho belge, « à la culture très hiérarchisée et à la gestion méthodique de Daimler s’oppose la gestion plus horizontale et créative de Chrysler ». Une guerre d’égos s’engage dès 1999 entre les responsables des différentes marques du nouveau groupe, à plusieurs échelles de décisions. Ce conflit larvé, qui noyaute l’ensemble des instances du groupe, se solde par le départ retentissant de nombreux cadres de Chrysler au début des années 2000. D’autant que les responsables allemands avaient la ferme intention d’imposer leurs méthodes à leur nouvelle conquête américaine, Daimler ayant mis la main au porte-monnaie pour acquérir la marque américaine.
Peu de synergies, des conflits qui paralysent la gestion et des échecs commerciaux retentissants : tel est le catastrophique constat opposé en 2006 à Jürgen Schrempp, artisan de la fusion entre les deux groupes et dirigeant de l’ensemble créé. Ce fut assez pour débarquer ce dernier dans le but d’insuffler un vent de modernité sur Daimler-Chrysler.
Divorce retentissant
L’homme de la dernière chance fut choisi parmi les dirigeants historiques de Daimler-Chrysler. L’allemand Dieter Zetsche, figure rendue sympathique par son imposante moustache blanche, est débauché en 2006 pour remplacer Schrempp à la hâte. Parachuté dirigeant de Chrysler en 2000, le charismatique quinqua connaît bien le groupe allemand et ses spécificités. Si bien que son objectif est clair : faire rigoureusement l’inverse de son prédécesseur. Fini l’autoritarisme germanique : sur les derniers mois de l’année 2006, les équipes de Chrysler sont recomposées et se voient confier une plus grande latitude.
Seulement, il était trop tard. L’annonce en 2007 des résultats catastrophiques de l’année 2006 coupe l’herbe sous le pied de Zetsche qui prend conscience de l’impossibilité de combler le trou béant laissé par plusieurs années de mauvaise gestion. La perte estimée à 1,5 milliards de dollars côté Chrysler sonne le couperet fatal de l’union.
Dès mai 2007, Daimler annonce ainsi la vente de 80,1 % de sa participation dans Chrysler. L’heure du spin-off a sonné, et Chrysler se retrouve entre les mains du fonds américain Cerberus Capital Management. Chrysler retrouve ainsi sa patrie d’origine, et avec elle l’espoir d’une gestion adaptée à ses caractéristiques. Au-delà de l’échec qu’elle signifie, cette annonce fait grand bruit du fait du montant pour lequel Daimler accepte la cession du groupe américain: 7,4 milliards de dollars, soit une décote de quasiment 30 milliards par rapport au prix d’achat de ces mêmes participations en 1998. Un gouffre, qui, cumulé à d’autres mauvaises décisions, menace de faillite le groupe allemand à la renommée pourtant centenaire.
Quant à Chrysler, miné par des pertes abyssales et peu aidé par un nouveau propriétaire ayant eu les yeux plus gros que le ventre, la faillite devient une évidence. Le groupe chéri des Américains est en réalité sauvé par son État du fait d’un heureux concours de circonstances. La crise de 2008 est passée par-là, et l’État américain n’est plus prêt à connaître à nouveau le scénario catastrophe de la banque Lehman Brothers. Dès avril 2009, Chrysler passe donc sous la protection dite du chapitre 11, à l’instar de plusieurs autres grands groupes outre Atlantique.
Moins politique que les deux premiers cas traités dans le cadre de cette série, l’échec de la fusion entre Daimler et Chrysler réaffirme un prérequis essentiel d’une telle opération : la nécessité de favoriser les synergies sur le plan managérial et culturel. Si elles ne s’appuient pas sur une culture d’entreprise commune et sur une répartition claire des tâches entre les deux entités préexistantes, les synergies créées par une fusion n’induiront pas de profitabilité durable pour le nouveau groupe qui en est issu.
Illustré par Victor Pauvert