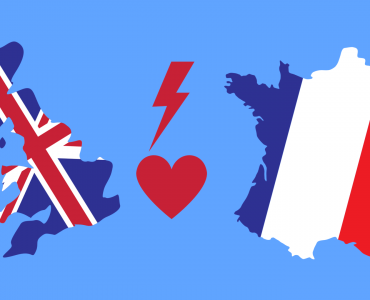Depuis plusieurs semaines, une récurrente rengaine se propage sur les plateaux télévisés et dans la presse. De doux murmure à perspective quasi-sûre, le spectre de la dissolution de l’Assemblée nationale hante chaque jour un peu plus nos députés, élus depuis seulement un semestre. Cette prérogative, réservée au chef de l’État par la constitution de la Ve République, qui semblait lointaine il y a encore quelques mois, semble avoir recouvré sa jeunesse pour opérer un retour fracassant dans notre vie démocratique. Cette résurrection est, chacun le sait, motivée par la forte instabilité qui domine la chambre basse du parlement depuis les élections législatives de juin, qui ont signé l’échec du parti présidentiel à obtenir une majorité absolue sur cet hémicycle. Une première depuis le passage au quinquennat, soit en quasiment vingt ans ! A situation exceptionnelle, recours potentiel à une prérogative exceptionnelle. Le pari du président est pourtant particulièrement risqué et risque de s’avérer la fausse bonne idée de son second mandat.
Bévues historiques
La prérogative de dissolution ne date pas d’hier. Il s’agit d’un mécanisme particulièrement éprouvé, introduit la Restauration, en 1814. Conservée dans les lois constitutionnelles de 1875, il ne faut attendre que deux ans pour que son utilisation par le président de la République d’alors, le maréchal Patrice de Mac-Mahon, aboutisse à une crise institutionnelle majeure. La crise survenue le 16 mai 1877, commence par la nomination, ce même jour, d’Albert de Broglie, émanant de la droite monarchiste, à la présidence du Conseil des ministres. Et ce alors même que l’Assemblée nationale est dominée, depuis les élections de 1876, par le parti républicain de Léon Gambetta. Face à la polémique créée, le président Mac-Mahon use de sa prérogative exceptionnelle et dissout l’Assemblée nationale un mois plus tard, le 16 juin. Les 14 et 28 octobre 1877, de nouvelles élections législatives ont lieu après trois mois de vacance du parlement. La victoire des républicains de Gambetta est incontestable et le Président doit se conformer à la décision de la chambre basse : il démet Albert de Broglie de ses fonctions le 19 novembre 1877. Témoin de la faiblesse de l’exécutif face à un parlement d’une couleur opposée, cette affaire enterre le recours à la dissolution pour l’intégralité de la durée de la IIIe République.
Si la dissolution constitue l’un des outils démocratiques majeurs de la IVe République, elle n’est pas étrangère à la situation de forte instabilité parlementaire et gouvernementale que redoutaient tant les rédacteurs de la constitution de 1958. Malgré des réticences parmi ces derniers, le droit de dissolution est consacré à l’article 12 de la nouvelle constitution. Au contraire du dispositif complexe de dissolution prévu par la constitution de la IVe République, ce nouveau droit de dissolution est simplifié par son caractère quasi-discrétionnaire à l’usage exclusif du président de la République, sur consultation préalable du Premier ministre et des présidents des deux assemblées.
L’exemple le plus emblématique de l’usage de ce mécanisme par le président de la République n’est pas, contre toute attente, l’une des dissolutions prononcées par le général De Gaulle. Il s’agit bien de celle utilisée par l’un de ses lointains héritiers, le président Jacques Chirac. Erreur de débutant pour beaucoup, cette dissolution est restée dans les annales comme l’une des bévues politiques les plus raillées de la Ve République. En 1995, Jacques Chirac fait son entrée à l’Élysée et prend la suite de quatorze ans de présidence socialiste incarnée par François Mitterrand. Et cette entrée en fonction est facilitée par l’écrasante majorité de droite héritée des législatives de 1993. Cependant, Jacques Chirac est peu satisfait de cette majorité, qu’il n’a pas portée personnellement et qui le seconde mal. L’on se souvient notamment de la débâcle de la réforme des retraites soumise par le Premier ministre d’alors, Alain Juppé, en 1995. Le 9 février, la décision est prise : il y aura une nouvelle dissolution de l’Assemblée nationale, pour conforter la majorité du Président et attirer plus de fidèles sur les bancs de l’hémicycle. Face aux prévisions du creusement des déficits pour 1998, le président avance le scrutin qui se tiendra trop tôt pour lui permettre de rassembler ses troupes. Face à lui, la figure du socialiste Lionel Jospin sort de l’ombre et s’impose aux yeux des Français. Ainsi, c’est une majorité socialiste, la fameuse « Gauche plurielle », qui remporte les élections organisées les 25 mai et 1er juin 1997. Le président, vaincu, devra gouverner en cohabitation durant les cinq années suivantes.
Ce bref exposé historique montre sans ambiguïté les risques inhérents à l’activation du droit présidentiel de dissolution. Et au vu des clivages politiques actuels, alimentés par des crises multiformes, il n’y a pas de raison que les nouvelles élections se déroulent mieux que les dernières, ni que celles ayant abouti aux deux échecs politiques précités.
Dernier recours
Il serait cependant malhonnête de vilipender une éventuelle inconséquence du gouvernement. La majorité a ses raisons que la raison ne peut ignorer. Rappel à l’ordre démocratique pour des gouvernants qui se sentaient pousser des ailes, le résultat des législatives de juin constitue un véritable point d’arrêt pour la dynamique impulsée par le président depuis 2017.
En juin, beaucoup, dont l’auteur de ces lignes, se réjouissaient de la perte de cette majorité. En somme, comment blâmer les adeptes du parlementarisme qui voyaient dans ce résultat la consécration du consensus dans la prise de décisions ? Comment déplorer le renouveau d’une Assemblée trop souvent méprisée, prise par erreur pour une pâle chambre d’enregistrement sans pouvoir ni personnalité ?
Cet espoir de lendemain de victoire fut cependant de courte durée. Le tableau était sans doute trop beau. Il laisse malheureusement place à un terrible constat : face à des oppositions majoritairement irresponsables, les intuitions peinent à montrer une résilience suffisante pour assurer la bonne tenue des affaires courantes.
Pourtant, les outils prévus par la constitution de la Ve République pour s’extirper d’un désaccord entre le gouvernement et le Parlement foisonnent. Tous penseront évidemment à l’article 49.3 de cette même constitution. Il permet au gouvernement de faire passer sans vote le texte qu’il présente, tout en s’exposant au rejet de ce texte par une motion de censure présentée par un dixième de l’Assemblée, et qui, si elle est votée, entraîne la chute de ce même gouvernement. Michel Debré, l’un des pères de la constitution de 1958, le qualifiait de « disposition quelque peu exceptionnelle pour assurer, malgré les manœuvres, le vote d’un texte indispensable »1https://www.lejdd.fr/Politique/quest-ce-que-larticle-493-4107737.
Le caractère exceptionnel dans l’esprit de cet article aura attisé les interrogations du lecteur averti. Comment qualifier cet article d’exceptionnel, lorsqu’il est utilisé pour faire passer une part toujours croissante de textes, malgré, parfois, une majorité absolue du parti gouvernemental à l’Assemblée nationale ? Pour réaffirmer l’exception, la réforme constitutionnelle de 2008 a ainsi limité le recours au 49.3 à un seul texte par session parlementaire, hormis le projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale2Ibid..
Déjà utilisé à dix reprises en six mois par la Première ministre Élisabeth Borne, cet article confronte rapidement le gouvernement à ses limites. Et ce du fait d’une opposition systématique de bon nombre de groupes parlementaires, qui affirmaient notamment, avant même le dépôt du projet de loi de finances auprès du parlement, leurs velléités d’obstruction. Comment gouverner dans ces conditions, dans un contexte de profonde irresponsabilité des récipiendaires d’une part significative des votes des Françaises et des Français ?
A situation exceptionnelle, que l’analyste le plus audacieux pourrait qualifier de trahison démocratique, mesure encore plus exceptionnelle. La dissolution apparaît clairement comme la dernière parade, le dernier recours, pour redonner ses lettres de noblesse à un parlement dévoyé. La dernière chance accordée à une constitution ballottée par les crises et donc l’adaptation à la nouvelle actualité politique est de plus en plus questionnée.
Alternative risquée
Pour un grand nombre d’observateurs convaincus de la nécessité de sauvegarder la constitution, le choix de la dissolution s’impose. Mais si cette dernière a témoigné par le passé des risques qui lui sont inhérents, le contexte politique actuel semble bien plus dangereux que celui d’alors. Quasi inexistante sur les bancs de l’Assemblée en 1997, l’extrême droite, déjà présente par trois fois au second tour des présidentielles, rassemble désormais 89 députés. Plusieurs facteurs laissent à penser que le Rassemblement national possède de grandes chances d’apparaître comme le grand gagnant d’une dissolution.
Tout d’abord, le discrédit de la NUPES, coalition des gauches sous la houlette de La France Insoumise, promet une véritable bérézina électorale pour les partis qui la composent. Entachée par des affaires multiples, au premier lieu desquelles les accusations et la condamnation à l’encontre de l’étoile montante du parti de gauche radicale, Adrien Quatennens, la gauche peine à conserver la crédibilité morale suffisante pour exister en tant qu’alternative à la majorité. Par ailleurs, le retrait relatif de Jean-Luc Mélenchon de son parti et de cette coalition laisse ce bloc sans chef et en proie à des forces centrifuges destructrices. La fronde engagée par la députée Clémentine Autain à l’encontre du nouveau chef de file de la France Insoumise, Manuel Bompard, est symptomatique de la perte de cette formation pourtant prometteuse. Enfin, la politique systématique d’opposition à toutes les mesures prises par le gouvernement, sans véritables arguments, laisse songeur quant au potentiel démocratique d’une telle force politique. Tout est ainsi combiné pour présager une claque électorale de grande ampleur pour cette coalition qui se place pour l’heure à la deuxième place en nombre de sièges obtenus.
Ensuite, si la majorité a pu convaincre par son sérieux depuis le début de la législature, elle ne pourra gagner de sièges qu’auprès de la frange modérée de son électorat, déjà majoritairement acquise à sa cause. Les perspectives de croissance de cette coalition se limitent à peau de chagrin, et impliqueraient de chiper les sièges des quelques députés d’opposition déjà favorables à une attitude coopérative, issus principalement des rangs du Parti socialiste et des Républicains. L’intérêt de croître aux dépens de ces partis alliés est donc limité. La situation peut même se montrer contre-productive car il est évident qu’il sera beaucoup moins aisé de gagner les circonscriptions acquises à la France Insoumise et au Rassemblement national, en quête de radicalité.
La question qui se pose est la suivante : à qui profitera l’effritement du groupe NUPES ? Contre les attentes de certains, il est probable que les sièges perdus par La France Insoumise soient gagnés par le Rassemblement national, dans un mouvement général de prime à la radicalité. Si le gouvernement a convaincu – ou plutôt conforté – les modérés, le parti majoritaire n’a rien fait pour convaincre les opposants au président, qui lui vouent, pour certains, une haine viscérale. D’autant que les 49.3 successifs n’ont pas incité au consensus.
Si la dissolution semble s’imposer au vu du contexte politique marqué par l’irresponsabilité des oppositions, il faut donc se demander à qui profitera le crime. Et ce sera certainement à l’extrême droite. Comment assumer le risque d’une éventuelle cohabitation avec le Rassemblement national ? Cette perspective effrayante pour la majorité et pour une grande partie des oppositions, même si sa probabilité reste infime, peut constituer un argument dissuasif suffisant pour écarter la perspective de dissolution. Sans cela, une alternative s’ouvre : une responsabilisation de la NUPES, dans une logique du « tout sauf le RN », ou une réforme constitutionnelle afin de repenser et d’affirmer le mode de gouvernement par consensus, au sein d’un régime à la composante parlementaire affirmée
Illustré par Constance Leterre-Robert