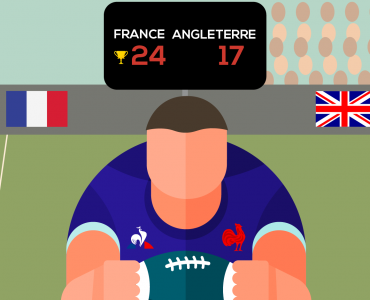Dans la multitude des clivages qui déchirent aujourd’hui les nations d’Europe, il en est plus d’un dont l’histoire s’étale sur plusieurs siècles. Parmi ceux-là, il faut compter celui qui oppose, dans la péninsule italienne, les adeptes de la mentalité guelfe à ceux de la pensée gibeline. Derrière ces termes à l’apparence sibylline et à la signification peu claire pour l’observateur français se cache une réalité politique très vive, un débat d’idées qui n’engage rien de moins que le destin de notre voisin transalpin.
Le glaive et le goupillon, la couronne et la tiare
Afin de comprendre en quoi, précisément, consistent les mentalités guelfe et gibeline, il convient d’en revenir à leur fondement historique. C’est pourquoi un détour par l’histoire médiévale italienne s’impose. De la proclamation du Saint-Empire romain germanique en 962 au début des guerres d’Italie en 1494, la péninsule se caractérise avant tout par la fragmentation politique, à laquelle s’ajoute un clivage Nord/Sud. En effet, les terres qui s’étendent au sud de Rome sont déchirées par les querelles d’influence qui voient s’affronter Byzantins, Arabes, Normands et Aragonais. Par conséquent, elles peinent à développer une identité propre. À l’inverse, au nord de la Ville Éternelle, de riches et puissantes cités-États, à l’image de Florence ou de Milan, se trouvent sous la tutelle d’un empereur allemand, qui leur apporte, moyennant leur soumission, sa protection face aux menaces extérieures – un système féodal en somme. Enfin, entre les deux, à Rome, le pape dispense des paroles qui résonnent dans toute l’Europe chrétienne.
À l’époque, la séparation des pouvoirs temporel et spirituel n’est pas encore tout à fait claire ; au Moyen-Âge, l’Italie se caractérise donc par une polarisation qui oppose les partisans de l’empereur allemand à ceux du pape romain. Celle-ci devient très explicite lors de la querelle des investitures de 1075-1122, qui oppose les deux camps sur la question du pouvoir de nomination aux charges ecclésiastiques. Lorsqu’à la Diète de Roncaglia, en 1158, l’empereur Frédéric Barberousse affirme sa volonté de faire passer l’Italie sous contrôle impérial direct et d’y envoyer ses propres administrateurs, c’est donc tout naturellement que les cités-États du Nord du pays se tournent vers le pape, Alexandre III. L’esprit guelfe est né : de petits pouvoirs locaux, férocement attachés à leur indépendance, cherchent le soutien du pouvoir religieux pour résister à la menace d’une intégration dans un ensemble territorial plus vaste. Le conflit entre le pape et l’empereur, qui jusqu’ici était resté confiné aux poussiéreuses bibliothèques des théologiens, prend une tournure militaire, politique, économique.
En mars 1167, les villes de Bergame, Brescia, Crémone et Mantoue forment la première Ligue lombarde, alliance assez souple entre diverses villes du Nord de l’Italie, et dirigée contre l’empereur. Neuf ans plus tard, les cités lombardes coalisées remportent une première victoire décisive contre les troupes impériales à la bataille de Legnano. C’est donc sans susciter la surprise que des siècles plus tard, le parti de la Ligue du Nord, nommé en référence à la Ligue lombarde, en fera un de ses mythes fondateurs. La bataille de Legnano joue un rôle fondamental dans la construction de l’identité nationale italienne. Pour s’en convaincre, il suffit de consulter la seconde strophe de la troisième partie de l’hymne national italien : « Des Alpes à la Sicile / Partout est Legnano ». Cette strophe fait de Legnano l’unique ville italienne, Rome à part, à avoir sa place dans l’hymne national. Chaque année, elle fait aujourd’hui encore l’objet de commémorations. Après cette bataille, en 1183, la Ligue lombarde parvient à arracher à Barberousse la paix de Constance, qui met momentanément fin au conflit et leur reconnaît des droits particuliers. Un succès d’autant plus retentissant que l’empereur Barberousse était parvenu sans difficulté à mettre au pas les autres provinces de son empire.
La Ligue lombarde est le premier modèle d’unification de l’Italie, une sorte de confédération entièrement décentralisée, placée sous la bénédiction du pouvoir religieux et dirigée contre toutes les menaces à son indépendance. Mais ce modèle ne fait pas l’unanimité, loin de là. L’Italie médiévale se divise durablement en deux camps, avec d’une part les guelfes, partisans du pape, et de l’autre ceux de l’empereur, les gibelins. Leur affrontement prend fin avec le début des guerres d’Italie en 1494, qui voient les Allemands chassés de la péninsule au profit des Français puis des Espagnols. Mais les questions soulevées par l’antagonisme originel – en particulier la place à donner au pape dans une Italie unifiée, son caractère fédéral ou confédéral, la possibilité pour l’Italie de n’être qu’une partie d’un plus vaste ensemble – restent bel et bien en suspens : ni l’empereur, ni le pape ne surent parvenir à unifier la péninsule sous leur coupe, et ainsi aucun des deux camps ne peut se prétendre plus légitime que l’autre. Ainsi, il n’est guère surprenant que l’opposition entre guelfe et gibelin ait ressurgi au moment de l’unification de l’Italie.
Guelfes et gibelins à l’heure du Risorgimento (1848-1945)
Les conquêtes de Napoléon Bonaparte amenant avec elles leur lot d’idées nouvelles, et la révolution industrielle, qui fait basculer le monde dans l’ère du capitalisme triomphant, nourrissent en Europe le sentiment nationaliste. En quête d’un modèle pour l’unité italienne, les penseurs de la péninsule se tournent tout naturellement vers le passé. Le clivage exposé précédemment s’en trouve revigoré, et les intellectuels italiens se divisent entre néo-guelfes et néo-gibelins.
Le néo-guelfisme est prôné par Vincenzo Gioberti (1801-1852), auteur qui promeut une synthèse philosophique entre catholicisme et libéralisme. Son modèle politique est celui d’une confédération des principautés italiennes, placée sous la houlette du pape. Les néo-guelfes dominent la pensée politique italienne jusqu’au Printemps des peuples. En effet, en 1849, Pie IX, jusqu’alors figure de proue des néo-guelfes, se rallie au camp de la réaction et soutient l’empire d’Autriche, qui contrôle depuis le Congrès de Vienne de 1815 la Vénétie et la Lombardie, dans son entreprise de répression des mouvements nationalistes du nord de l’Italie. Les néo-guelfes s’en trouvent momentanément décrédibilisés. Dans son entreprise italienne, Napoléon III leur offrira pourtant son soutien, défendant lui aussi le modèle d’une Italie confédérale. Mais sa chute en 1870, suivie de celle des États Pontificaux dont il s’était fait le protecteur, fait entrer le mouvement néo-guelfe dans une phase de déclin. Il se réinvente alors, et s’accoutume au parlementarisme ; les néo-guelfes fondent ainsi les mouvements démocrates-chrétiens, qui influencent aujourd’hui encore la politique italienne.
Si le mouvement néo-gibelin le précède, Benedetto Croce (1866-1952), grand penseur libéral italien qui s’inscrit dans la continuité de la pensée de Hegel, n’en demeure pas moins l’une de ses figures de proue. Les néo-gibelins souhaitent faire de l’Italie un État unifié par un gouvernement laïc. La question de la forme du gouvernement a donc moins d’importance à leurs yeux que celle de la place du pouvoir religieux. En matière de politique, la pensée de Benedetto Croce a surtout rayonné sur le centre gauche, voire la gauche.
Une première possibilité de synthèse entre ces deux mouvements apparaît avec Giuseppe Mazzini (1805-1872), qui écrit que les oppositions entre guelfes et gibelins doivent être dépassées si l’Italie veut être véritablement unie. Aux gibelins, il emprunte l’idée de mettre fin à l’autorité temporelle du pape, ainsi que celle d’une monarchie puissante et centralisée ; aux guelfes, cette passion de l’indépendance qui les caractérise si bien, et le respect de l’autorité spirituelle du souverain pontife. Cette synthèse mazzinienne l’emporte finalement, jusqu’à ce qu’elle soit remise en question.
Les nouveaux visages de l’empereur et du pape
Le début du XXIe siècle voit en effet une résurgence du clivage entre guelfes et gibelins, quoique celui-ci adopte une forme nouvelle. Quitte à le caricaturer, il pourrait être résumé de la manière suivante.
D’un côté, il y a les héritiers de la pensée gibeline, partisans de l’idée selon laquelle l’Italie n’est que la partie d’un plus grand tout, méfiants vis-à-vis de l’utilisation de symboles religieux, favorables à un système fédéral. Ils appartiennent, en somme, aux partis centristes, europhiles, laïcs ; de plus, l’écart de développement entre le Mezzogiorno (Sud de la péninsule) et le reste de l’Italie suscite chez eux un élan de solidarité, en lieu et place du ras-le-bol du contribuable milanais moyen.
De l’autre, il y a les tenants du guelfisme, attachés à l’indépendance des pouvoirs locaux, réceptifs aux discours traditionalistes qui prétendent trouver leur source dans un catholicisme rigoriste. Ils sont plus méfiants à l’égard de l’Union européenne, ce pouvoir lointain qui rogne sur leur souveraineté ; plus méfiants, aussi, à l’égard du fédéralisme, qui voit les populations des grands pôles urbains du Nord transférer une partie de leur richesse au Sud. La principale force politique incarnant cette mouvance guelfe, on l’aura compris, est le parti de Matteo Salvini. Son nom originel, la Ligue du Nord, était, on le sait bien, une référence non équivoque à l’ancestrale Ligue lombarde.
Toute la question est de savoir si une synthèse entre la pensée guelfe et la pensée gibeline est encore envisageable. À ce jour, aucune proposition en ce sens n’a véritablement émergé dans le débat public. Pour les élites italiennes, un retour à Mazzini s’impose peut-être…