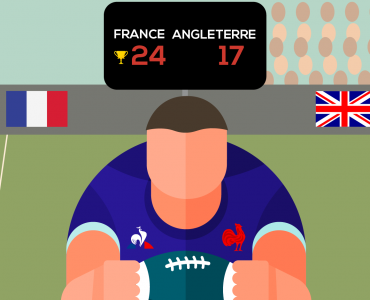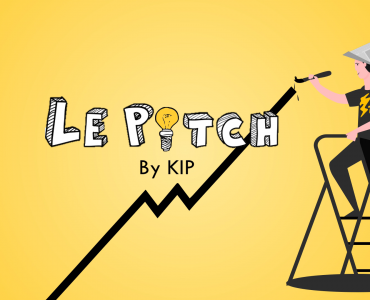Je me faufile dans les rues de la Sérénissime. Nous sommes le 23 février, et le carnaval bat son plein. Une foule costumée et insouciante se presse sur les pavés de la place Saint Marc. Soudain, l’un des passants parvient à attirer mon regard. Il porte un masque qui ne ressemble à aucun de ceux que j’ai vu jusque-là. Pas de couleur, de plumes, de coiffe exubérante, mais un simple rectangle de plastique blanc, qui s’étire sur la partie inférieure de son visage. Je devine à grande peine la ciselure de ses lèvres, avant qu’il ne disparaisse dans une masse informe et anonyme.
L’abîme. Face à une telle vision, ce sont des siècles d’angoisse et de souffrance qui ressurgissent en moi, avant même d’avoir eu le temps de comprendre ce qu’il m’arrive. Des draps moites, des nuits suffocantes ; une toux rauque, les larmes d’une femme. Des visions confuses viennent troubler ma pensée. J’ose à peine bouger. Serait-ce encore elle ?
Comme pour fuir un mal que je sens grandissant, je saute dans le premier train pour la Lombardie. C’est peut-être une erreur, mais je ne le sais pas encore. Padoue, Vérone, Brescia, les gares se succèdent et se ressemblent toutes. Derrière-moi, je surprends une conversation entre deux touristes, l’une que je pense être française, et l’autre qui se dit chinoise. Je fais mine de ne pas entendre, mais bien sûr le mot est prononcé. C’est le même, dans toutes les langues, et tout le monde le comprend. À peine ai-je le temps de chasser cette pensée de mon esprit, que mon téléphone vibre et se tortille sous le feu des notifications de divers journaux. « Épidémie », « patient zéro », « quarantaine », « confinement ». Les mots se croisent et s’emmêlent dans mon esprit. En Lombardie, que l’on me décrit comme l’un des foyers européens de l’épidémie, je ne sais plus à quoi m’attendre. Tout à coup, mon train marque un arrêt, à l’entrée de Milan ; une voix en italien est censée m’expliquer pourquoi, mais je ne comprends pas. Agacé et inquiet, je dois finir le trajet en métro.
La faim me tiraille, et je m’enfonce dans la première grande surface que je rencontre. La scène à laquelle j’assiste vaut tous les plus grands films apocalyptiques américains. Les rayons sont presque vides. Des chariots bien remplis défilent sous mes yeux. Je reprends mes esprits. Après tout, cette scène est anodine ; cela doit arriver ici tous les dimanches soirs, lorsque les familles viennent faire leurs courses… N’est-ce pas ?
Le lendemain matin, je commence à tourner en rond. Je cherche à focaliser mon attention sur les modalités pratiques de mon retour en France. Un train pour Lyon, encore un autre pour Massy-Palaiseau, puis le RER C. Une pensée parasite me traverse. Et si j’étais assis à côté de quelqu’un qui l’a ? Mon téléphone vibre, encore. À Perrache[1], un bus est confiné. Six heures de trajet, dans un espace clos et abondamment climatisé, ça ne pardonne pas, me direz-vous. Je trouve un train. Un contrôleur passe. Il porte lui aussi un masque, et pour lui c’est bien plus qu’un simple déguisement. À chaque nouvel arrêt, de nouveaux voyageurs montent, arborant fièrement le rectangle de plastique.
L’efficacité des masques est douteuse, je le sais bien. Pourtant, il s’agissait pour ces gens du premier réflexe, le plus spontané. Il faut dire qu’il y a dans le fait de porter ces insignifiants cache-misères quelque chose de presque superstitieux, qui m’évoque quasi instantanément les amulettes et autres babioles des temps anciens. Le fait que l’Église catholique ait pris l’initiative d’en envoyer en Chine aurait bien dû mettre la puce à l’oreille des plus sceptiques. « Si je le porte, il ne m’arrivera rien de mal… », se répètent-ils sûrement. Prise dans son ensemble, la médecine moderne ne parvient pas à chasser mon angoisse. Je sais en effet qu’un virus peut muter et prendre de nouvelles formes, plus agressives et plus résistantes. Fils de médecin, je sais également qu’une fois malades, les personnels de santé ne peuvent plus grand-chose pour nous ; et qu’une fois pleins, les hôpitaux n’offrent plus aux nouveaux patients de perspective de guérison.
« L’agent pathogène en question n’est létal que pour les patients qui présentent déjà une condition pulmonaire fragile », me dit-on. Pour l’instant, du point de vue éthique, cela arrange bien du monde : il n’y a que les personnes âgées qui en meurent, et c’est commode parce qu’après tout elles ont déjà bien vécu. Finalement, c’est logique, si elles ne mouraient pas de cela, ce serait d’autre chose. La maladie ne nous donne pas encore, pour l’instant, un sentiment criant d’injustice. Il est toujours possible d’en plaisanter autour d’une bière. Les rapatriés en quarantaine ? Ils s’amusent bien, ils ont du temps libre et en plus il fait beau… Mais le fait que des femmes enceintes ou des enfants puissent contracter le virus, cela, c’est dérangeant. Il n’est nul besoin d’éliminer, comme l’a fait la peste noire, le tiers de la population de l’Europe pour susciter en moi le sentiment du tragique. La mort d’un chérubin innocent y suffit amplement.
Assis dans mon TGV sur un fauteuil d’un violet certainement mal choisi, Prométhée triomphant sis au sommet de toute la modernité technique, je me plonge dans une méditation profonde, à laquelle ma voisine reste malheureusement indifférente. Des images continuent à défiler dans mon esprit. La veille encore, je contemplais les plafonds richement décorés de la Scuola San Rocco. Quelle coïncidence ! En effet, Saint Roch était fréquemment invoqué par les Vénitiens lors des épidémies de peste les plus dévastatrices.
Je m’interroge sur les manifestations esthétiques qu’a pu prendre la maladie. Dans l’Histoire de l’art, la peste noire (1347-1352) a tout changé. Jusqu’à la peste, on ne représentait pas la Mort. Elle ne pouvait pas faire l’objet d’une esthétisation et demeurait dépeinte comme un monstre grotesque, qui n’aurait aujourd’hui rien de terrifiant. Avec la Peste, elle commence à prendre un visage, une forme. C’est ce squelette tout drapé de noir que nous connaissons aujourd’hui. Avec l’épidémie, on commence également à représenter les morts avec davantage de détail. L’art funéraire connaît un essor sans précédent : les gisants mal dégrossis des églises romanes laissent place à des transis d’un réalisme terrifiant, sculptés à même le marbre.
Dans les palais vénitiens se succédaient toute une série d’œuvres picturales qui seraient bien trop longues à décrire. Quelques thèmes se répètent cependant : la danse macabre, le Dit des trois, la peste justinienne, sont tant de topoï qui préfigurent les vanités hollandaises. La Peste a également induit une inflexion majeure dans l’art de représenter le Christ. Jusqu’ici dépeint comme triomphant, il devient souffrant. Les crucifixions exposées dans les églises vénitiennes regorgent ainsi de détails morbides ; une telle précision, de la part de ces artistes auxquels les dissections étaient encore prohibées, ne peut s’expliquer que par l’omniprésence de cadavres dans leur vie quotidienne.
Plus ma réflexion avance, plus la dimension eschatologique de la Peste m’apparaît. Elle frappe sans distinction, sans justification apparente, les grands comme les humbles, les vieux comme les jeunes, les vicieux comme les vertueux. Je me souviens alors que les Anciens surent, en ces temps-là, inventer une série de rituels visant à assurer le salut des âmes de manière autonome, les prêtres ayant été fauchés par l’épidémie de peste. Nous y étions : le moment de la naissance de l’ars moriendi, l’art de bien mourir. Lorsque je vois aujourd’hui le continent européen déserté par les prêtres, je me dis qu’une telle sagesse ne peut pas faire de mal.
Puis viennent les modernes. En effet, la Peste a eu un rayonnement artistique bien au-delà de la période historique qui la vit naître. Mort à Venise, de Thomas Mann, confrontation entre ce que ce monde peut avoir de sublime, et ce qu’il a de passager et de dérisoire. Puis, Les Mouches, de Jean-Paul Sartre, qui fait de la peste notre châtiment. Quelle est notre faute ? Peut-être une mondialisation trop radicale, qui laisse trop de place à ce qui est matériel. Il serait temps de rappeler aux hommes la vanité des choses…
Mais bien sûr, toutes ces œuvres ne sont rien, à côté de celle qui est aujourd’hui dans tous les esprits, au point qu’il n’est même plus nécessaire de la nommer. Alors que je suis enfin à Lyon, je croise une femme qui rentre de Marseille. Amusant, me dis-je : en 1720, Marseille fut, elle aussi, ravagée par une peste meurtrière. J’apprends que là-bas, dans la rue, on trouve des rats morts. J’ai comme un sentiment de déjà vu : « le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais… »
Sources et renvois
[1] Il s’agit d’une gare lyonnaise.