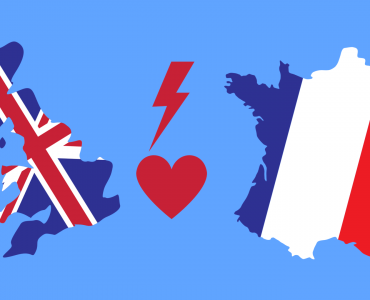Rabelais écrivait dans son Pantagruel que “Science sans conscience n’est que ruine de l’âme”. Évidemment, aujourd’hui, cette phrase nous semble être un slogan adapté au triste projet atomique d’Oppenheimer, ou à n’importe quelle nouvelle avancée de la génétique, avec en premier chef le fameux CRISPR-Cas9, “ciseau génétique” présentant le potentiel de modifier notre génome à l’envi. On peut trouver l’origine de cette tendance au XIXème siècle, lorsque Mary Shelley écrivait l’histoire évocatrice d’un scientifique fou et génial nommé Frankenstein, dépassé par sa propre création scientifique non moins géniale. On peut parler des nombreux scénarios de destruction de l’humanité par des robots ou autres intelligences artificielles surpuissantes… Il est indéniable que la science, en particulier la recherche, peut effrayer, et que l’on peut légitimement s’interroger sur le bien ou le mal qu’elle parvient in fine à accomplir. On peut donc généralement s’accorder sur le fait qu’il faut que la recherche serve l’intérêt public ; cependant, cela implique que ce soit l’argent public qui la finance, et il y a un débat plus épineux. De ce débat naît un problème de taille : faute d’intérêt du public, il suffit souvent d’un chèque aux multiples zéros pour pouvoir faire dire ce que l’on veut aux travaux des scientifiques en mal de financements.
La recherche, un domaine fermé qui ne nous intéresse que lors de ses coups d’éclats
Pour le grand public, c’est presque du même sac de Scapin que sortent les vaccins contre la polio, les missiles hypersoniques et les traitements antirétroviraux du VIH. La science est fascinante lorsqu’elle donne l’impression de pouvoir sauver le monde ou d’y mettre fin. Le reste du temps, elle est incompréhensible ou ennuyeuse. En réalité, la majorité des projets de recherches sont assez peu affriolants, tant cet univers est rigide. Une expérience ne vaut rien sans un échantillon suffisant, sans expérience témoin et, si l’on peut se permettre ce luxe, sans collègues pour la reproduire et la confirmer. Être chercheur, c’est exercer un métier ingrat, entre des projets qui prennent des années entières à se concrétiser et la recherche effrénée de financements qui, bien souvent, manquent.
En 2020, la France entière se gargarisait de son nouveau prix Nobel de Chimie, Emmanuelle Charpentier (une des deux co-inventrices du mécanisme CRISPR-Cas9), alors qu’elle a définitivement quitté son pays natal après son doctorat, probablement faute de moyens adaptés à ses ambitions. Emmanuelle Charpentier a fait le choix de travailler tout de même pour des organismes universitaires ou publics, comme le Centre de recherche allemand Max-Planck duquel elle est actuellement directrice. Une autre voie est celle de la recherche privée, celle qui n’a pas le bien commun mais le profit pour objectif. Cette recherche-là se dédouane de bien des blâmes classiques que l’on peut faire : elle est rentable, efficace, optimisée et surtout, elle ne coûte strictement rien au contribuable. Mais est-ce une bonne idée de nous laisser ainsi convaincre ? S’il apparaît que l’on peut faire de la recherche rentable, on peut se demander si le souci de rentabilité fait de la bonne recherche et, encore plus important, s’il encourage ou non à prendre de bonnes conclusions. Science sans conscience n’est que ruine de l’âme, certes. Mais si la seule chose que l’on cherche à éviter est la ruine financière, on peut faire assez peu de cas de la conscience.
Mauvaise science, bonne publicité
Parlons d’un temps que les moins de cinquante ans ne peuvent pas connaître : avant 1976, soit avant que la publicité ne soit interdite en France pour les entreprises de tabac. Aujourd’hui, non seulement cette publicité est interdite, mais les paquets de cigarettes ont pour obligation de porter des images peu ragoûtantes et des mentions menaçantes, pour bien faire comprendre aux clients potentiels qu’ils prennent une mauvaise décision. A l’époque, ce n’était pas exactement la même histoire. On pouvait trouver de la publicité à peu près partout, sans aucune mention des risques pour la santé. Les premières études qui soupçonnaient un lien fort entre tabagisme et cancer datent pourtant des années 1920. Les industriels du tabac, parfaitement au courant de ces recherches et conscients du fait que le compte à rebours était lancé, n’ont pas lésiné sur les dépenses pour faire reculer la prise de conscience collective. Comment ? En combattant la bonne science avec de la mauvaise science. Les individus écoutent peu les scientifiques, mais beaucoup les médecins. Il faut donc faire approuver notre produit indéniablement dangereux par la médecine, et garantir ainsi que tout le monde doute de ces recherches inquiétantes. Ce phénomène était particulièrement fort aux Etats-Unis, et on peut aisément retrouver des affiches et autres spots publicitaires de Camel ou Lucky Strike dans lesquels des médecins vantent les bienfaits du tabac sur la santé. “Vous êtes une femme enceinte et l’accouchement vous fait peur ? N’hésitez pas à fumer un paquet par jour : il est démontré que les mères qui fument accouchent de bébés plus petits et souffrent moins pendant l’accouchement. D’autres déficits ? Non, quelle idée ! On vous dit bien d’écouter votre médecin…” Mauvaise science, nouvelle démographie d’acheteurs. Une génération d’enfants sacrifiés, mais des profits qui décollent. Science sans conscience fut loin d’être la ruine de Marlboro et Camel.
Prenons un second exemple, celui d’une entreprise que l’on connaît bien, qui vend un produit aux conséquences certes moins graves sur la santé que Lucky Strike, mais qui a encore mieux compris l’utilité de l’outil du financement de la recherche. En 2015, Coca-Cola fait un don d’un million de dollars à la fondation de l’Université du Colorado, argent directement alloué au budget de l’institut de recherche Global Energy Balance Network. Juste avant, c’était quatre millions de dollars qui avaient été gracieusement offerts par l’entreprise pour financer les recherches de deux membres fondateurs de ce même institut. Une preuve de grande philanthropie de Coca-Cola ? Un intérêt fort pour la recherche ? Évidemment que non. La contrepartie de cet argent était la publication de recherches montrant que la consommation de trop nombreuses calories jouait un rôle marginal dans l’obésité et la prise de poids, et concluant que l’activité physique était suffisante pour se maintenir en forme, même si on consommait des aliments hypocaloriques (à l’exemple des boissons gazeuses vendues par ce généreux donateur). A une époque où l’obésité commençait à être considérée comme un sujet prioritaire de santé publique aux Etats-Unis, Coca-Cola s’est servie de la recherche pour faire en sorte d’y minimiser la part de responsabilité des boissons gazeuses ultra-caloriques. Si l’entreprise est prise la main dans le sac et interrompt en 2017 ses financements pour raison de “coupes budgétaires”, ce cas a interrogé très sérieusement le rôle de l’argent du secteur privé dans la recherche à utilité publique. Mauvaise science, bonne publicité, s’étaient-ils probablement dit…
Bonne science, mauvaises intentions
Se servir de son argent pour mentir ou influencer est somme toute une pratique assez classique. Il y a de quoi interroger les financements extérieurs de la recherche, mais pas nécessairement de quoi se révolter. Le cas qui suit est autrement plus scandaleux.
Nous sommes une génération qui a grandi avec une sensibilisation accrue à l’enjeu du réchauffement climatique. Il a été intégré dans nos programmes scolaires, fait la une des journaux à répétition, a une importance primordiale jusque dans le cursus d’HEC Paris. On a probablement tous déjà marché pour le climat, vu et lu d’innombrables vidéos et articles sur le sujet. En 2022, c’est une évidence. Mais posez-vous la question : depuis quand ce sujet s’est-il imposé ? Les derniers discours climato-sceptiques sont morts au courant des années 2010. Al Gore et le GIEC reçoivent le prix Nobel de la paix en 2007 pour leurs efforts de sensibilisation à la crise climatique. Le premier rapport du GIEC est publié en 1990. La notion de développement durable apparaît pour la première fois en 1987. Il a fallu du temps pour que la réalité du réchauffement climatique devienne une évidence, il en a fallu encore plus pour que l’action dans ce sens n’apparaisse comme (à défaut de devenir) une indéniable nécessité. Nous l’avons moins vécu que nos parents, mais il y a eu de nombreux efforts pour discréditer le discours scientifique à l’origine de ces évolutions. Au cœur de ces efforts, les entreprises qui allaient le plus souffrir de nouvelles législations anti-réchauffement climatique, et en tête, les entreprises fournisseuses d’énergie fossile. Tout cela paraît compréhensible, presque logique : on savait encore mal, cela ne les arrangeait pas, ils se sont battus et ils ont finalement perdu. Total n’avait aucun intérêt à mener des études sur le réchauffement climatique, il paraît donc sensé qu’ils ne l’aient pas fait. Total non. ExxonMobil, par contre, c’est un autre débat.
En Juillet 1977, donc dix ans avant le premier rapport du GIEC, les scientifiques d’Exxon rendent un rapport à la rigueur impeccable sur les effets des émissions de CO2 sur le climat et la planète. Exxon y a non seulement cru, mais a poussé encore plus loin. Au cours des années 1970 et 1980, les scientifiques d’Exxon creusent les recherches sur les effets de ces émissions, dont les responsables majeurs sont les compagnies pétrolières, et arrivent à une conclusion : il reste entre cinq et dix ans avant que la nécessité de prendre des décisions radicales en terme de stratégie énergétique ne devienne critique. Les projections des scientifiques d’Exxon étaient parfaites, et les documents de 1977 prédisent avec une effrayante exactitude les données actuelles. Dans le scénario de l’inaction la plus complète, évidemment. Pourtant, en 1988, lorsqu’un scientifique de la NASA affirme devant le congrès américain que la planète a déjà commencé à se réchauffer, Exxon remet publiquement en cause l’exactitude de ces recherches. Ainsi commence une longue campagne de décrédibilisation des scientifiques engagés pour mettre en place un consensus sur le réchauffement climatique. Exxon a mené des recherches d’une qualité admirable, allant jusqu’à mener des analyses clés (et coûteuses) qui auraient grandement servi aux autres scientifiques. Exxon savait pertinemment que ces recherches mettaient un compte à rebours sur leur activité, et a donc décidé de ralentir au maximum leur acceptation, allant jusqu’à créer en 1989 une coalition climato-sceptique (the Global Climate Coalition) qui ne sera dissoute qu’en 2002. Cette entreprise a mené de meilleures recherches que les autres, a eu des résultats bien plus tôt, qui étaient bien plus concluants. La date butoir pour mener des actions de petite portée et préserver notre planète était 1987. Les véritables efforts ne commenceront que trente ans plus tard. En 2022, quarante-cinq ans après le premier rapport d’Exxon, les mesures radicales ne sont encore qu’en discussion. Nous sommes partis dans cette course avec quarante ans de retard, quarante ans qui auraient pu tout changer, quarante années pendant lesquelles Exxon mettait chaque jour la planète plus en danger pour s’assurer du maintien de ses profits. Sous l’œil des hauts-placés d’Exxon, le réchauffement climatique passait d’un problème gérable à une crise dont on pourra difficilement sortir. Il y a là une preuve indéniable que le privé sait faire de l’excellente science. Mais qu’il n’en fera jamais que ce qui est dans son intérêt dans le court-terme.
La science ne pourra sauver le monde que si décidons collectivement de nous y intéresser
De nombreux scénarios se dessinent aujourd’hui, et le plus optimiste est celui dans lequel les évolutions technologiques et scientifiques résolvent la crise climatique et plus ou moins tous les autres problèmes du monde. Ce scénario n’est pas le plus improbable : ce sont bien des progrès techniques qui ont empêché à répétition la bombe P de Ehrlich d’exploser. Mais ces nombreux cas nous apprennent que les entreprises privées ne feront jamais plus que ce pour quoi elles sont faites : du profit, à n’importe quel prix, pour peu que ce ne soit pas elles qui paient. Le monde de la recherche publique n’est pas non plus sans problème, avec notamment des entreprises de publications comme Elsevier qui empochent la majorité des recettes, alors que cet argent devrait être réinvesti. Il demeure que si l’on veut compter sur la science, il est nécessaire que celle-ci soit tournée vers le bien commun. Pour ce faire, il n’y a pas de secret : il faut que vous, moi, votre voisin et ma prof de maths de sixième ayons tous intérêt à ce que la meilleure science possible soit faite. Accepter de la financer collectivement et comprendre qu’elle nous concerne profondément. Ignorer la recherche et la laisser aux mains d’entreprises privées est probablement un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre.
Illustré par Constance Leterre-Robert