Issu de transformations structurelles de nos sociétés, le confinement ne manquera de laisser une trace tout aussi significative sur celles-ci. Au-delà de notre aspiration à retrouver autant que possible une vie normale, de pouvoir enfin se déplacer et se rencontrer comme bon nous semble, le simple respect des mesures de protection sanitaires nécessitera des changements significatifs dans nos rapports personnels. De façon plus profonde, la période actuelle a amorcé une réflexion sur nos modèles de société, alors que des voix nombreuses s’élèvent pour rénover, refonder, réinventer nos sociétés, créer quelque chose de neuf à partir de ce qu’elles ont été. Tant concernant l’économie que le climat, tant concernant les libertés individuelles que la sécurité de tous, la période à venir s’annonce pleine de débats. L’urgence économique et les préoccupations sanitaires ont déjà plaidé pour des mesures énergiques, la nécessité de s’adapter à un monde nouveau en entraînera d’autres. Nous nous concentrons dans cet article sur le rôle que les Etats pourront jouer dans ces transformations et nous essayerons de montrer à quel point c’est notre rapport à la connaissance qui pourrait être remis en question, ouvrant autant de risques que de potentialités.
Quels sont alors alors les chemins que nous pourrons alors emprunter?
Place et rôle de l’État après le confinement
Dans Après la Mondialisation, le sociologue allemand Jürgen Habermas prédisait un avenir sombre aux Etats, qui devaient muter pour s’adapter à une mondialisation qui sapait leurs fondations : les frontières. L’État-Nation devait soit se fondre dans des entités plus grandes, soit se dissoudre dans une mondialisation qui érodait ses prérogatives. Trop lent, trop lourd et dépassé, l’État ne pouvait que s’adapter aux exigences des marchés, et s’effacer dès qu’il le pouvait pour leur permettre d’exprimer leur efficacité. C’est pourtant bien vers lui que nous nous sommes tournés en cette période compliquée; nationaliser eut par exemple paru être une hérésie il y a trois mois, c’est aujourd’hui une hypothèse plausible pour sauver une économie affaiblie.
Disons-le plus nettement : l’État peut redevenir leader. Il est vrai qu’en France, l’État est souvent apparu hésitant voire inconstant. Cependant, hors de nos frontières, la crise du coronavirus a été l’occasion d’un net regain d’opinions favorables pour les pouvoirs en place, notamment en Allemagne où Angela Merkel obtient début mai le chiffre impressionnant de 83% d’opinions favorables. Ce n’est pas un hasard si les différentes allocutions des pouvoirs en place font référence au temps long, voire osent parler de planification pour la première fois depuis longtemps. Personne n’aurait imaginé notre État suffisamment fort il y a quelques mois pour réquisitionner des sites ou prendre en charge l’essentiel des salaires. C’est pourtant ce qu’il a mis en place dans de nombreux pays, malgré l’épée de Damoclès que fait peser l’endettement.
La crise actuelle peut aboutir à des changements majeurs, selon une logique esquissée dans Fondation par Isaac Asimov. Dans cet ouvrage de science-fiction, Asimov développe la psychohistoire, dont le but est de prévoir les dynamiques historiques des sociétés. Il propose plusieurs tendances pour le comportement des sociétés de grande taille, notamment une forme d’inertie des sociétés qui continuent en somme sur le même chemin tant qu’une crise ne vient pas les en détourner. A vrai dire, nos sociétés, peu confrontées ces dernières années à des dangers collectifs imminents avaient perdu le sentiment de devoir s’adapter. Tout allait plus ou moins bien jusque là – rien ne nous menaçait directement – et une forme d’inertie, faite d’habitudes acquises, nous faisait perpétuer le même mode de fonctionnement sans trop y penser. Seul un choc pouvait induire un appel à une réflexion sur le modèle. Jusque-là évoquées à mi-voix, étouffées par les bruits familiers de la sécurité et de la prospérité, l’urgence climatique et les ébouriffants progrès techniques remettent pourtant en cause les fondements de notre société, et seront des thèmes incontournables dans l’Après. Comment pourrons-nous concilier confort matériel et impératifs écologiques? Quelle orientation donneront-nous aux progrès techniques? Questions vertigineuses qui appellent à l’État pour fournir un cadre législatif et surtout le faire appliquer. Quelles que soient nos opinions à leur sujet, elles appelleront des débats passionnés.
L’époque qui a de fortes de chances de s’achever sous nos yeux avait pour principales caractéristiques des préoccupations individuelles, relatives notamment au confort matériel, en grande partie car les sociétés n’avaient pas à affronter collectivement de problématiques remettant en cause leur existence même. Le monde à venir posera quant à lui des questions collectives, des droits des personnes à l’heure des nouvelles technologies – de la géolocalisation aux progrès des IA – qui remettent en question notre façon de vivre dans un environnement appauvri par le réchauffement climatique.
La pierre angulaire de ces évolutions sera à mon sens notre rapport à la connaissance.
La connaissance au XXIème siècle
Dans sa Physique, Aristote met en place une distinction entre différentes catégories de la connaissance. Deux modes de relation au savoir sont dépeints par Aristote, que sont la technique (techné) et la science (épistémè). Pour en maîtriser les effets, trois vertus intellectuelles doivent y être associées, à savoir la sagesse (sophia), l’entendement (noûs) et la prudence (phronesis). La technique, contrairement à la science, est directement liée à la production économique qu’elle facilite en proposant des solutions techniques pour en minimiser les coûts. La science est pour sa part davantage imprégnée d’une volonté de découverte pour la connaissance en soi, sans forcément d’application pratique. Elle est associée à une vertu personnelle, en donnant à celui qui la possède la possibilité d’acquérir une vision d’ensemble. Cette perspective aristotélicienne perdura jusqu’aux débuts de la Renaissance, avant que petit à petit la technique ne prenne le dessus[1].
Le XXème siècle subordonna définitivement la science, ce qu’on appelle aujourd’hui la recherche fondamentale, à la technique. Comme le dit si bien l’ingénieur français Louis Armand, il n’y a « plus de barrière entre la vile technique et la noble science. Une grande symbiose des connaissances, de l’habileté de la main-d’oeuvre et de l’esprit, voici l’image conforme à la grande convergence de notre époque ».
Là se trouve sans doute le trait marquant de nos sociétés. L’accent donné à la production lui permet d’utiliser à plein les possibilités offertes par les découvertes scientifiques, quasiment sans limites sauf danger évident, comme dans l’armement nucléaire. Production et recherche interagissent alors dans un cercle vertueux, les bénéfices engendrés par les découvertes précédentes permettant de financer les recherches suivantes. Les réalisations de cette alliance sont incroyables, définissant le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui, avions, voitures, téléphones, ordinateur, médicaments pour en donner les exemples les plus frappants. Grâce à toutes ces réalisations, notre monde est surtout un monde de foi en la technique; cette technique qui a si merveilleusement amélioré nos conditions de vie. Il est aussi un monde de confiance envers les fameux experts qui chacun dans leur branche en sont les symboles. Et ce n’est pas anodin.
Tous les progrès accomplis dans les différents domaines ont formidablement accru les connaissances de l’humanité, mais il est désormais impossible pour un homme en particulier d’être à la pointe de la connaissance en dehors d’un nombre très restreint de sujets. En se perfectionnant, les différentes branches de la connaissance s’isolent dès lors de plus en plus les unes des autres. Difficile donc d’acquérir cette vision d’ensemble qu’Aristote associait à la science.
Parallèlement, les dernières années ont vu un repli certain de la confiance envers la technique. Numérique, financier ou génétique, ses dernières applications inquiètent de plus en plus, notamment comme facteur de pollution ou d’inégalités et se voient de plus en plus fréquemment contestées. Notre rapport à la technique est ainsi remis en cause.
La crise actuelle a de fortes chances de lui porter le coup fatal, les crises ayant tendance à faire émerger des tendances qui se développaient sans qu’on y fasse forcément gare. On ne posera pas forcément directement la question de la technique, encore moins celle de notre rapport à elle. La plupart de nos débats vont pourtant s’y ramener d’une façon ou d’une autre. Les débats climatiques vont poser la question de l’utilisation des différents moyens de transports, ainsi que la direction dans laquelle nous voulons orienter la recherche. Les débats autour de la société de surveillance que nous développerons vont impliquer une réflexion sur l’utilisation des possibilités de traçage. Les débats autour de la démocratie vont avoir pour thème dominant la protection de celle-ci face à l’utilisation malveillante des données.
L’époque actuelle est donc caractérisée par une volonté de remettre en question certains choix de société et un choc de nature à ouvrir le débat. Cela tombe bien, le progrès technique entre aujourd’hui dans une phase nouvelle, où il est vecteur de changements d’une portée jusque là inédite, sur nos écosystèmes, sur nos libertés individuelles et notre accès au monde. Le monde de demain devra d’abord et avant tout questionner le progrès technique pour lui permettre de continuer à nous apporter ses bienfaits, pour permettre de continuer à enrichir les connaissances et les possibilités de l’humanité sans remettre en question son bon fonctionnement. Pour ce faire, la réflexion sur le progrès devra retrouver une place indépendante aux côtés de la technique. Je pense donc que les années à venir seront le théâtre de débats sociaux importants, quant à nos rapports à la démocratie, à l’environnement ou à l’économie et que ces changements, de façon profonde, détermineront ni plus ni moins que notre rapport au monde.
Prenons par exemple les débats autour du traçage numérique. L’épidémie de coronavirus aura eu un effet très favorable pour les défenseurs d’une telle technologie. La raison en est simple. Du moment que l’épidémie restreint notre perception de nos gouvernants à leur seule efficacité contre le virus, toute action présentant des résultats visibles ou suffisamment frappante pour rassurer la population acquiert un immense crédit. À l’heure où l’on vient à en craindre pour nos vies, de telles restrictions paraissent nécessaires, peut-être même souhaitables, la liberté devant s’incliner devant la sécurité. Et comme nous sommes tous liés dans cette épidémie, l’intérêt général doit primer sur les réticences des réfractaires et rend très difficile toute contestation. Car celle-ci ne pourrait se faire que sur la base de la sensibilité de chacun, d’un désir de liberté aux racines personnelles, auxquels ses opposants pourront opposer un argument commun et puissant, l’intérêt général.
C’est bien sûr le scénario d’une société de surveillance qui réapparaît ici, à vrai dire celui d’une société de surveillance librement consentie. Plus qu’Orwell, c’est Hobbes et son Léviathan qui nous en donne un avatar possible. Son fondement ne sera pas une propagande généralisée, mais une tendance naturelle à vouloir mesurer, quantifier, rationaliser, maîtriser et minimiser les risques pour apaiser les craintes et dans ce but accumuler les données et pénétrer toujours plus en avant dans la vie privée. Cette société de surveillance serait donc une société de surveillance civique et technique de chacun par tous, où chacun voudrait minimiser les risques engendrés par les autres, ce qui conduira naturellement les États à transcrire dans la loi à terme le consensus qui peut-être s’imposera, après débats.
Rien n’est plus difficile à retrouver qu’une liberté qu’on a abandonné. Plus encore lorsque ce renoncement part d’une bonne intention, celle de pousser au plus loin ce que nous savons et mesurons pour limiter les risques, d’utiliser à plein les moyens techniques dont nous disposons dans ce but…
Dans le monde de demain, savoir ce sera toujours pouvoir. Mais savoir devra aussi signifier vouloir, choisir et réfléchir ensemble à ce que nous voulons comme type de société.





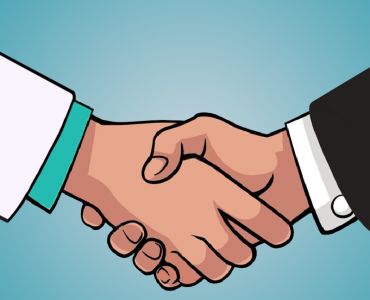
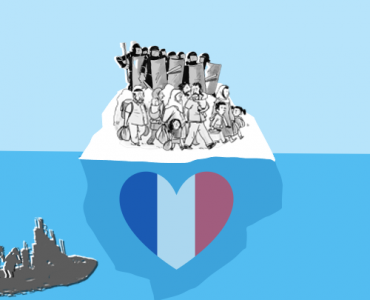





[…] seuls à même de prendre en charge ces mutations (avec des enjeux que présentent cet article ? Ainsi, faut-il vraiment déposséder une grande partie des citoyens de la chose […]