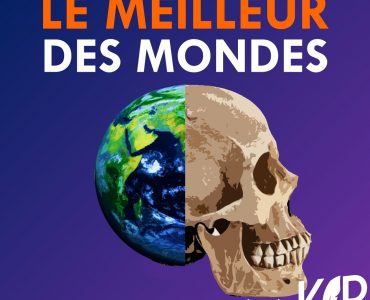Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdoğan sont deux chefs d’État que le Time désigne comme des « strongmen »[1]. La notion d’homme d’État fort n’est pas nouvelle, mais semble connaître actuellement un essor. Face aux incertitudes que soulèvent la mondialisation et l’estompement des frontières, avoir pour dirigeant un homme fort capable de nous protéger peut sembler rassurant. Les frontières représentent notre protection contre l’étranger, or elles tendent à disparaître. Mais l’homme fort tel un messie est là pour nous défendre contre les barbares. L’inquiétude est réelle, il suffit de voir la popularité de ce modèle : Poutine, Erdoğan, Orbán, Duterte, Bolsonaro, Trump… tous en sont issus. Aussi, ils sont associés à un certain compromis entre la démocratie et les droits de l’Homme. C’est un échange : les citoyens échangent une partie de leur liberté contre plus de sécurité. Quelle alternative peut-on trouver à ce modèle ?
Vers la pureté
Il est naturel de vouloir la sécurité. La sécurité est un droit fondamental auquel chacun aspire, la prérogative régalienne par excellence. Il est difficile de concevoir que quelqu’un aime véritablement vivre dans l’insécurité (qu’elle soit économique, politique ou de toute autre nature). Mais peut-on se fier à une seule personne pour assurer la sécurité de tout le monde ? Bolsonaro ne protège pas les tribus amazoniennes. Poutine ne protège pas les personnes LGBT de Tchétchénie. Xi Jinping ne protège pas ses opposants politiques et les Ouïghours. Ont-ils seulement essayé ? Là est le problème, le paradoxe de la sécurité promise par les strongmen : ils proposent une sécurité fondée sur la norme et l’exclusion, qui n’est donc octroyée qu’à certains. Ils répondent à la peur de l’étranger d’une partie de la population par plus de peur, tout en promettant de défendre le peuple face aux envahisseurs et aux traitres. On se croirait dans une chasse aux sorcières digne de McCarthy ! Ce qui est différent nous effraie, et il est tellement plus rassurant de l’éloigner, de rester entre gens semblables et de mettre toute différence de côté !
Seulement, si on garde un modèle de peuple « parfait », « pur » et qu’on supprime dans une population tout ce qui l’éloigne de cet idéal, que reste-t-il ? Les différentes origines, on les enlève ! Les contestations, on les muselle ! Les divergences d’opinions et de manière de penser, à la poubelle ! Il ne reste plus que des citoyens parfaits. L’ordre va régner. C’est l’avènement d’une nouvelle ère de paix. Loué soit le strongman. Mais il y a quelque chose qui cloche… Tous les citoyens sont pareils. Ils se ressemblent tous, ne peuvent penser que d’une seule manière, et adulent leur dirigeant bien-aimé. Ils ne se sont pas rendu compte qu’ils sont devenus des moutons dans un enclos, en sécurité des loups qui rodent, mais à la merci du loup bien plus dangereux qui les surveille et guette, prêt à mordre celui qui s’écarte du droit chemin. Il suffit de voir ce qui arrive aux journalistes en Turquie, aux dissidents en Chine ou en Russie.
La sécurité est-elle atteinte ? Peut-être. Mais à quel prix ? Le berger, loin de protéger et de guider ses bêtes, est devenu un prédateur qui cherche sa prochaine proie. Dans cette recherche de nourriture, il trouve toujours de nouvelles cibles, et la définition du citoyen – (du mouton ?) – parfait se réduit de plus en plus. Je n’aime pas ce modèle, on peut sûrement trouver mieux.
Un mouton ? Très peu pour moi !
Pourquoi aurait-on besoin d’être des moutons ? Des bêtes ? Des copies plus ou moins conformes du même modèle irréel ? La politique, c’est gouverner la cité. Gouverner, ce n’est pas dresser. La personnalité politique n’a pas à chercher à dompter les citoyens et à repousser les méchants envahisseurs. Elle devrait plutôt guider son pays dans la meilleure direction possible, vers la paix et la prospérité. Ce n’est pas en dressant les gens les uns contre les autres qu’un de ces objectifs sera atteint. Au mieux, on divisera la population, jusqu’à faire cohabiter plusieurs groupes distincts qui ne se connaissent pas et se méfient les uns des autres, prenant la moindre réaction pour une attaque. Mais devoir se méfier implique de devoir être sur ses gardes, en permanence, avec tous ceux qui pourraient être différents ; par conséquent, on ne peut que rarement laisser son esprit se reposer en compagnie des autres. C’est épuisant ! À titre de comparaison, cela doit être bien plus reposant de chercher à connaître un minimum l’autre et de lui faire confiance. La paix, la tranquillité, la sécurité tant cherchées ne s’obtiendront qu’avec le dialogue et la confiance. La méfiance n’engendre que la méfiance, il faut au contraire dissiper les facteurs d’hostilité. Or, sans connaître l’autre, comment peut-on désamorcer l’impression qu’on a de lui ? Il faut avoir des raisons pour faire confiance à l’autre, il faut comprendre qu’il ne représente pas nécessairement un danger, voire un ami potentiel. Ce que les strongmen semblent ne pas pouvoir ou en tout cas ne pas vouloir comprendre ni considérer. Bolsonaro, Poutine, Trump… tous sont dangereux et clivants, alors que le dirigeant devrait rassurer tout le monde et inspirer confiance – l’enjeu n’est pas de faire l’unanimité, mais d’éviter de dresser une partie de la population contre une autre.
« Wir schaffen das »
Une phrase prononcée par Angela Merkel incarne cette confiance : « Wir schaffen das ». Elle représente un idéal du chef d’État qui me paraît être une bonne alternative au strongman. Pendant une grande partie de son mandat, Angela Merkel a inspiré confiance à la majorité des Allemands. Elle les a remerciés en leur donnant sa confiance, la confiance qu’ils pouvaient tous ensemble bâtir une chose essentielle : une société apaisée et ouverte qui sait accueillir la différence et aider ceux qui sont dans le besoin – d’autant plus que cet accueil relève d’une nécessité démographique et économique pour l’Allemagne et non d’une générosité totalement désintéressée. À cet instant, elle ne faisait pas que veiller sur un troupeau de moutons, elle reconnaissait la valeur de chacun et disait à tous qu’ils avaient la capacité de réussir. Elle a incité la société allemande à s’ouvrir, c’est sûrement son geste le plus noble.
Plus encore, quand je pense à une image d’ouverture, de président en lequel je serai prêt à avoir confiance, je pense à la photo de Jacinda Ardern portant un voile après les attaques de Christchurch[2]. La Nouvelle-Zélande ne pouvait offrir d’image plus grande, plus digne que celle-ci. À la suite des fusillades, au lieu de jouer à la récupération politique, les personnalités politiques étaient unies et apportaient leur soutien inconditionnel à la communauté musulmane en deuil. Jacinda Ardern incarnait une image de profonde ouverture et d’humanité. Mais aussi d’espoir, et c’est peut-être ça le plus important : il faut se relever, sans se diviser, et se soutenir mutuellement. C’est la seule manière d’avancer dans la bonne direction.
Avec cet espoir, les gens ne seraient pas des moutons apeurés demandant un berger et des barrières. Les strongmen deviendraient inutiles, et le monde se porterait très certainement mieux sans eux.
Sources et renvois
[1] Time, numéro 191, 14 mai 2018.
[2] Lien vers la photographie de Jacinda Ardern, prise par Kirk Hargreaves :