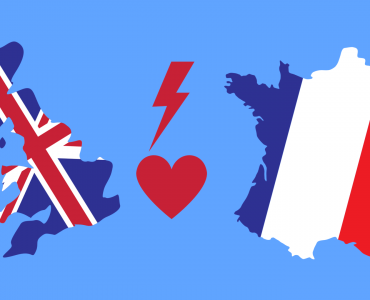Bête politique
18 septembre 2005. La liste CDU/CSU (parti Chrétien-Démocrate allemand) conduite par la jeune présidente du parti, Angela Merkel, remporte 35,2% des suffrages, devant le parti Social-Démocrate, le SPD, alors au pouvoir. Mais la politicienne de 51 ans deviendra-t-elle la première femme chancelière fédérale allemande ? Rien n’est moins sûr, étant donnée la pression exercée par le chancelier sortant, le social-démocrate Gerhard Schröder[1]. Comment trouver un accord de coalition avec ce parti, qui n’a remporté que quatre sièges de moins que la CDU/CSU au Bundestag ? Cinq semaines de tractations intenses furent nécessaires pour aboutir, le 25 octobre 2005, à la désignation d’Angela Merkel au poste de chef du gouvernement allemand.
Les négociations sont une seconde nature pour cette femme expérimentée et avisée, ancienne porte-parole du gouvernement de transition de RDA, en 1990, et ancienne ministre indéboulonnable du gouvernement Kohl. Il faut dire que sa jeunesse dans l’Allemagne communiste, la RDA, au sein d’une famille proche du régime, ne fut pas un long fleuve tranquille. Élève réservée mais brillante, son entrée à l’université fut compliquée par sa lecture d’écrits contestataires. Il fallut alors faire des concessions, négocier, faire profil bas, pour intégrer les formations d’élite de la République Démocratique Allemande.
Cette tradition du consensus est constitutive de la « marque Merkel », un style singulier en politique qui lui assure succès et popularité durant ses mandats. Le consensus, d’abord, dans cette « GroKo », coalition historique entre chrétiens-démocrates et socio-démocrates, qu’elle dirigera de 2005 à 2009, puis de 2013 à 2021. Cette coalition lui permet d’impulser un glissement à gauche de son parti, qui devient désormais plus représentatif d’un centre large que d’une droite modérée. Le but de Merkel est de représenter le plus grand nombre d’Allemands, d’acquérir le rôle de « Mutti », surnom affectueux désignant une mère tutélaire pour ses partisans. Cette image fut cultivée en permanence par la communication de la chancellerie : « Mutti » fait elle-même ses courses, porte souvent les mêmes vêtements et n’hésite pas à user de son humour pour convaincre ses interlocuteurs. Communication ou réalité, cette stratégie fut victorieuse : jamais d’échec électoral pour la seule chancelière qui n’aura jamais été battue à une élection fédérale. Si elle se retire, c’est donc de son propre chef, non de celui de l’électorat.
Pourtant, une chancelière du consensus est-elle un atout pour les Allemands ? Rien n’est moins sûr. Faire consensus, c’est avant tout édulcorer, voire dénaturer, un programme politique qui fonde pourtant sa légitimité sur le résultat du vote démocratique. A vouloir s’adjoindre la plus grande part de partis possibles, Angela Merkel a mené un programme politique radicalement différent de celui pour lequel elle a été élue, et de ceux pour lesquels les autres partis ont obtenu des suffrages. Le programme Merkel est donc un programme qui ne repose, au fond, sur aucune légitimité démocratique. Il ne faut cependant pas nier que cette contradiction est inhérente au modèle politique allemand. Angela Merkel fut donc la chancelière de son pays, plus que de ses électeurs. Et ce dans la plus pure tradition politique allemande.
« Mutti » de l’Europe ou « Germany first » : pourquoi choisir ?
Pour autant, cette popularité repose-t-elle uniquement sur une image à succès, ou sur une vraie capacité à gouverner ? Les décisions de Merkel sont tranchées et parfois radicales, ce qui se fait parfois aux dépens de l’harmonie de l’Union Européenne : en 2011, elle décide la sortie allemande du nucléaire en dix ans, à horizon 2021. Et cette patte Merkel est payante pour l’Allemagne : une prospérité économique jamais démentie la suit durant ses seize années au pouvoir. Certains diront qu’elle bénéficie des mesures de libéralisation imposées par le précédent gouvernement, celui dirigé par Gerhard Schröder1La démocratie allemande est, dans son fonctionnement, différente de la nôtre. Le chancelier est désigné à l’issue des élections législatives du Bundestag. Pour devenir chancelier, il faut être à la tête d’une liste apte à former et diriger une coalition avec d’autres partis, afin d’obtenir plus de 50% des sièges au parlement. Au soir des élections, des tractations commencent entre les partis pour former une coalition. Ces négociations peuvent durer des semaines ou des mois – comme on le voit actuellement. C’est à leur issue que le chancelier est officiellement nommé par le Président allemand. connu pour son plan Hartz IV sur le marché du travail. Mais rien ne peut contredire un succès dans ce domaine : l’Allemagne se porte bien économiquement, même durant la crise de la Covid-19, relativement aux autres pays européens dont la France (5% de récession en 2020 contre 8,3% en France). Mais cette politique est avant tout centrée sur les intérêts économiques allemands : en témoigne la prise de position allemande sur le gazoduc russe Nordstream 2. Le gouvernement Merkel a toujours soutenu ce projet, censé acheminer le gaz russe vers le pays, du fait, notamment des besoins croissants de l’industrie allemande en gaz. Ce projet est, au contraire, condamné par nombre de pays européens. L’ex-président de conseil européen, le polonais Donald Tusk, vilipendait d’ailleurs la dépendance allemande au gaz russe, danger, selon lui, pour l’autonomie géopolitique de l’Europe entière.
Toutefois, si Merkel est avant tout la chancelière allemande, elle reste une figure de proue de l’européisme, une sorte de « Mutti » européenne. Dans l’impasse de la crise de la Covid-19, c’est d’une concertation qu’elle mène avec le président Macron que naît l’idée d’un plan de relance européen, fondé sur un emprunt commun. Ce jour de mai 2020, l’Allemagne trahit le camp de l’Europe frugale à laquelle elle était plutôt rattachée pour sauver la cohésion nord-sud européenne, déjà fragilisée par l’orthodoxie budgétaire allemande lors de la crise des dettes souveraines qui secoua le continent entre 2011 et 2015. Si Merkel a conscience des intérêts allemands, elle reste une mère protectrice pour une Europe plus que jamais menacée d’implosion. Cette capacité à tout concilier fait certes de Merkel une femme politique exceptionnelle. Sa constance et sa clarté perdent pourtant au change.
En demi-teinte
Si Merkel est indétrônable en termes de popularité, elle a essuyé des échecs durant son mandat. Comment l’éviter en seize ans de politique de consensus ? Sa politique de « Linksruck », glissement vers la gauche de la CDU/CSU, offre un espace pour une droite plus conservatrice et réactionnaire, la droite du parti extrémiste « Alternative für Deutschland » (AfD). Erreur politique incontestable dans un contexte global de montée de telles idéologies. Lancé en 2013, ce parti eurosceptique et islamophobe remporte succès sur succès, notamment 89 sièges au Bundestag à la dernière élection fédérale, en 2017. Si les derniers chiffres et sondages de l’AfD se tassent légèrement, ce parti reste l’une des principales forces politiques du pays, particulièrement en ex-Allemagne de l’Est, où les politiques mises en place pour le rattrapage économique à l’issue de la réunification n’ont pas montré leur pleine efficacité. Cet extrémisme est renforcé par les mesures d’immigration favorisées par Merkel, dont la plus emblématique est l’accueil de plus d’un million de réfugiés en 2015, sous slogan « Wir schaffen das ». Un vrai slogan caractéristique du style Merkel, issu d’un discours prononcé le 31 août 2015. Si les Allemands « y sont arrivés » comme le slogan l’indiquait, cela n’a pas été sans créer des tensions, instrumentalisées par les penseurs xénophobes de l’AfD ou d’autres mouvements radicaux. Malgré une capacité réelle d’intégration et d’accueil d’immigrants, cet épisode peut être considéré comme un des échecs politiques les plus cuisants des années Merkel.
Mais l’échec politique le plus cuisant de Merkel est sans aucun doute son ambitieuse politique énergétique lancée en 2011 : plus de nucléaire d’ici 2021 ? Mais comment produire l’énergie nécessaire à l’industrie allemande ? Cette politique a redonné la part belle au charbon dans le mix énergétique du pays, et ce alors même que l’Allemagne défend ardemment la transition énergétique européenne. En effet, si la part des énergies renouvelables a augmenté du fait d’une politique volontariste de construction, par exemple, de grandes centrales éoliennes, celle du charbon n’a pas réellement baissé depuis dix ans (27,9 % de la production d’électricité en 2019), ce qui fait de l’Allemagne un des pays les plus émetteurs de CO2 par habitant en Europe (à la deuxième place, derrière la Russie, en 2018). Faites ce que Merkel dit, mais ne suivez pas l’exemple Merkel… Cet échec relatif de la politique énergétique allemande fait passer la décision brutale de sortie du nucléaire pour un choix fait sous l’émotion de la crise de Fukushima. D’où une importante progression électorale du parti écologiste Die Grünen (« Les Verts ») qui leur permet d’atteindre la deuxième place aux élections européennes de 2019, avec plus de 20 % des suffrages, et de diriger le Land de Bade-Wurtemberg.
Si la politique menée par Angela Merkel a ménagé sa popularité, elle n’a donc clairement pas fait progresser celle de son parti, la CDU/CSU, grignoté à sa droite par l’AfD, à sa gauche par les Verts.
Couper le cordon
Quant aux limites de la communication de l’ère Merkel, il faut inévitablement revenir sur la portée écrasante de cette figure maternelle, en particulier dans le champ politique démocrate-chrétien. Qui pour remplacer Merkel ? Là est désormais la question : lorsque la machine à gagner de la CDU/CSU décide de se retirer, place à des rôles secondaires peu connus et incapables de fédérer à la manière de celle qui fut leur modèle. Peut-on parler de véritables héritiers, dans les figures de Markus Söder, ministre-président bavarois, candidat malheureux à l’investiture de la CDU/CSU, ou de Armin Laschet, ministre-président de Rhénanie du Nord-Westphalie et candidat à la succession de Merkel ? Lorsque la CDU/CSU dévisse dans les sondages à la veille des élections fédérales, a qui attribuer la faute ? Si l’on peut déplorer les échecs d’une campagne pas vraiment incisive de la part de Armin Laschet, il semble que ce soit avant tout l’ombre oppressante de Merkel qui plonge le Parti chrétien-démocrate dans un noir électoral complet. D’autant plus que la seule figure émergente des anciens gouvernements Merkel n’est pas démocrate-chrétienne : il s’agit bel et bien de l’ancien vice-chancelier et ministre fédéral des finances Olaf Schotz, qui fait remonter le SPD à des scores jamais atteints depuis des années. Crise de la CDU, renouveau du SPD ? C’est ce que confirme le résultat de l’élection fédérale du 26 septembre 2021 : le SPD est donné en tête, avec une courte avance, devant la CDU/CSU ; le parti vert s’affirme, malgré une campagne calamiteuse2La tête de liste écologiste aux élections, Annalena Baerbock, a fait l’objet de nombreuses attaques durant la campagne, auxquelles elle a peiné à répondre efficacement. En témoigne sa chute électorale à la suite des accusations de plagiat la concernant., comme la troisième force politique du pays, tandis que l’AfD reste au-dessus des 10% des suffrages. L’Union chrétienne démocrate est donc affaiblie par le départ de la figure de Merkel, figure des grands jours comme des mauvais pour ce parti depuis seize ans. « Femme la plus puissante du monde » depuis des années selon les classements internationaux, Angela Merkel reste incontestablement la femme la plus influente d’Allemagne. Une Allemagne qui semble avoir du mal à se détacher de sa « Mutti », à couper un cordon noué il y a 16 ans déjà. A la fin de l’année 2021, l’Allemagne devra pourtant prendre son envol, gouvernée par un nouveau chancelier. Merkel est morte, vive Merkel.