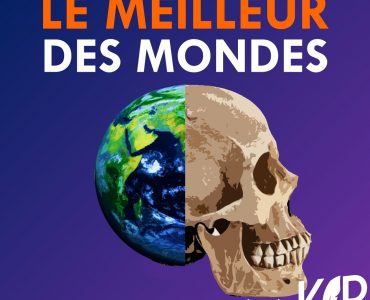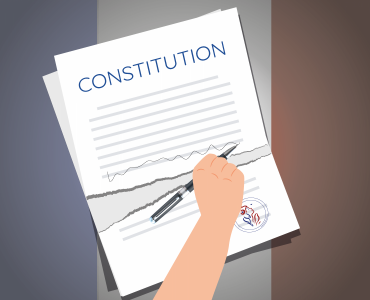Dans des récentes directives publiées par les Nations Unies, le Rapporteur Spécial Clément Nyaletsossi Voule tirait la sonnette d’alarme : « aucun pays ni gouvernement ne peut résoudre cette crise sanitaire à lui seul et je suis préoccupé par les tendances et les limitations inquiétantes qui émergent des rapports de la société civile dans le monde ». Il souligne que l’état d’urgence ne suspend pas les libertés de réunion pacifique et d’association, et rappelle que les mesures prises par les États pour endiguer le coronavirus doivent respecter le principe de légalité, de nécessité et de proportionnalité[1]. À l’heure de la plus grave crise sanitaire et économique depuis des décennies, ses craintes sont-elles justifiées ? La France parvient-elle à lutter efficacement contre la maladie tout en ménageant nos libertés ?
Limitation stricte du droit de circulation, mise en sommeil de fait du Parlement via le recours systématique aux ordonnances, prolongation des détentions provisoires… Nos libertés sont mises à rude épreuve par l’épidémie qui frappe de plein fouet le monde entier. Si ces restrictions peuvent paraître justifiées au regard de la gravité de la situation, elles n’autorisent pour autant pas toutes les mesures, et conduisent parfois à de graves dérives.
Une Constitution mise de côté
Le 21 mars dernier, le Parlement a adopté une loi organique en urgence pour faire face au coronavirus. En substance, cette loi composée d’un unique article ajourne les réponses du Conseil Constitutionnel aux recours des citoyens qui considèreraient que l’état d’urgence sanitaire porte atteinte à leurs droits fondamentaux. Il ne sera plus possible, de fait, pour les citoyens, de contester la constitutionnalité d’une loi portant sur l’état d’urgence sanitaire via une question prioritaire de constitutionnalité, et donc de la censurer. Ce mécanisme s’est pourtant révélé salutaire pour préserver nos libertés fondamentales, en particulier durant l’état d’urgence instauré après les attentats de 2015[2].
Le constitutionnaliste Paul Cassia, professeur à Paris I, s’insurge en affirmant que cette loi « ouvre la porte à tout, ça veut dire : on peut tout accepter… »[3]. On peut en effet imaginer de nombreuses dérives de la part du législateur, qui, défait du cadre protecteur de la Constitution, peut instaurer des mesures extrêmement contraignantes en bafouant tout principe de proportionnalité. Le Conseil Constitutionnel, dans une décision du 26 mars, a jugé cette loi conforme à la Constitution, amoindrissant donc le garde-fou constitutionnel qui encadrait le législateur[4]. Concrètement, le contrôle de constitutionnalité des lois est ajourné, nous empêchant donc de contester une loi au nom du respect des libertés fondamentales. C’est donc une première digue qui saute.
Des réponses timides du juge administratif
Du côté des juges administratifs, la réponse est également bien timorée, voire inquiétante. Le Conseil d’État, juridiction administrative suprême, apparaît désormais comme un auxiliaire du gouvernement plutôt que comme le gardien des libertés fondamentales.
En droit, il est possible pour tout citoyen de contester une décision qui aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative. Lorsqu’il s’agit d’une mesure administrative, c’est le Conseil d’État qui tranche en dernier lieu, et se fait donc l’arbitre impartial ménageant libertés et ordre public.
Depuis le 10 mars, le Conseil d’État a été saisi 115 fois, dont 70 fois en référé (c’est-à-dire en procédure d’urgence) sur des mesures prises pour lutter contre le coronavirus. Sur les 46 décisions qu’il a déjà rendues, 41 étaient des décisions de rejet. Le Conseil d’État, traditionnel protecteur des libertés fondamentales, ne fait donc ici qu’avaliser les décisions du gouvernement en lui fournissant un « certificat de légalité » comme le soulignent les avocats William Bourdon et Vincent Brengarth. Le professeur à Paris I Dupré de Boulois qualifie même le Conseil d’État « d’auxiliaire de la police administrative », alors qu’il en est traditionnellement le gendarme. C’est normalement à lui qu’il incombe de vérifier la fameuse trilogie des caractères nécessaires, adaptées et proportionnées[5] des décisions de police administrative, c’est-à-dire de restrictions des libertés afin de préserver l’ordre public. D’intransigeant gardien des libertés il est devenu adjuvant zélé du gouvernement : une autre digue s’effondre.
La tentation du tracking
Pour lutter contre le virus, le gouvernement envisage de recourir à une application, « Stop Covid », « pour limiter la diffusion du virus en identifiant les chaînes de transmissions », explique le secrétaire d’État au Numérique Cédric O. L’application permettrait de savoir si l’on a croisé récemment une personne infectée par le virus, et donc de se mettre en quarantaine pour briser la chaîne de transmission. Cela semble, a priori, une mesure utile et efficace pour lutter contre l’épidémie. Mais elle est aussi sujette à des dérives, puisqu’elle représente un premier pas vers une surveillance potentiellement généralisée des citoyens par l’État et donc une atteinte à la vie privée.
Le gouvernement a adopté un ton qui se veut mesuré. Il a assuré que l’application ne serait pas obligatoire, qu’elle traiterait les données en respectant l’anonymat et qu’elle n’instaurerait pas une géolocalisation précise des utilisateurs, préférant un recours au Bluetooth.
Cependant, les expériences de ce genre d’applications dans les autres pays ne sont pas rassurantes. Au-delà du cas extrême de la Chine, qui traque les données et constitue des fichiers nominatifs complets, le cas allemand est plus comparable mais également effrayant. Dans plusieurs régions, les données de santé des utilisateurs malades ont été transmises à la police, ainsi que les noms et adresses des personnes contaminées. En Basse Saxe, ce sont mêmes les noms et adresses des personnes qui ont eu un contact avec un malade qui ont été transmis aux autorités[6].
Il est donc nécessaire que le gouvernement français fournisse des garanties sur l’utilisation de ces données sensibles, pour assurer le respect de la vie privée des citoyens et désamorcer une situation qui pourrait éventuellement dégénérer.
Des mesures qui doivent rester temporaires
Que donc penser de toutes ces mesures ? Évidemment, certaines sont nécessaires pour lutter contre l’épidémie et sauver des vies. Cependant, il faut veiller d’une part à maintenir l’État de droit, même (ou surtout !) pendant un temps de crise, et s’assurer d’autre part que toutes les mesures dites exceptionnelles qui ont été mises en place seront supprimées une fois l’épidémie vaincue. Cependant, tel n’est pas toujours le cas ! L’exceptionnel et le temporaire deviennent parfois le principe, la règle, et perdurent dans le temps. Pensons par exemple à certaines dispositions de l’état d’urgence qui ont été transposées dans le droit commun par la loi « Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme » de 2017…
Dans une intervention télévisée du 16 avril, Gaspard Koenig, président du think-tank libéral Génération Libre appelait à faire l’inventaire de nos libertés de sorte à s’assurer de toutes les retrouver une fois le confinement terminé. Il rappelait également la réflexion de Michel Foucault dans son Histoire de la folie à l’âge classique sur les léproseries. Foucault y souligne qu’une fois la lèpre disparue, les léproseries, sortes de prisons isolées pour malades, n’ont pas pour autant fermé ! Les gouvernants y ont trouvé une bonne occasion d’y enfermer exclus, marginaux et autres vagabonds plutôt que de les désaffecter…
Prenons donc garde à nos libertés pendant cette crise temporaire pour ne pas les perdre une à une définitivement. Concluons donc sur une citation de Benjamin Franklin, qui nous mettait déjà en garde face au pouvoir démesuré que l’on accorde complaisamment à l’État au nom de la sécurité : « un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l’une ni l’autre, et finit par perdre les deux ».
Sources et renvois
[1] https://news.un.org/fr/story/2020/04/1066512.
[2] En 2015, dans le contexte d’état d’urgence à la suite des attentats terroristes, des questions prioritaires de constitutionnalité avaient permis de faire annuler certaines dispositions de la loi sur l’état d’urgence datant de 1955 (donc avant la Constitution de 1958 !), en particulier la généralisation des contrôles d’identité ou certaines interdictions de séjour.
[3] Contribution du professeur Cassia au Conseil Constitutionnel (contestation de la décision du Conseil) :
[4] Décision du Conseil Constitutionnel du 26 mars 2020 :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020799DC.htm.
[5] Le Conseil d’État dans son arrêt du 26 octobre 2011 « Association pour la promotion de l’image » précise les conditions dans lesquelles une mesure de police administrative peut être prise. Celle-ci doit être nécessaire pour maintenir l’ordre public, adaptée à la situation particulière et proportionnée, c’est-à-dire ménageant le maintien des libertés publiques en fonction de la gravité de la situation.
[6] Pour nos amis germanophones, voir cet article sur le traitement des données personnelles par les autorités allemandes :
Quelques précisions sur le mécanisme de Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) : « la question prioritaire de constitutionnalité est le droit reconnu à toute personne qui est partie à un procès ou une instance de soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit » (définition du Conseil Constitutionnel). Une fois déposée par l’une des parties au procès, cette QPC est préalablement examinée par le Conseil d’État (si le litige est couvert par le droit administratif) ou par la Cour de cassation (si le litige concerne le droit civil) afin de vérifier si la question est suffisamment sérieuse et légitime. Si tel est le cas, la juridiction renvoie la question au Conseil Constitutionnel, qui tranchera seul sur la constitutionnalité de la loi en question. Si la loi est inconstitutionnelle, le Conseil Constitutionnel pourra l’annuler. La loi organique de mars empêche le Conseil d’État et la Cour de cassation d’examiner des QPC jusqu’au 30 juin, si bien qu’aucune question ne peut être envoyée de fait au Conseil Constitutionnel.